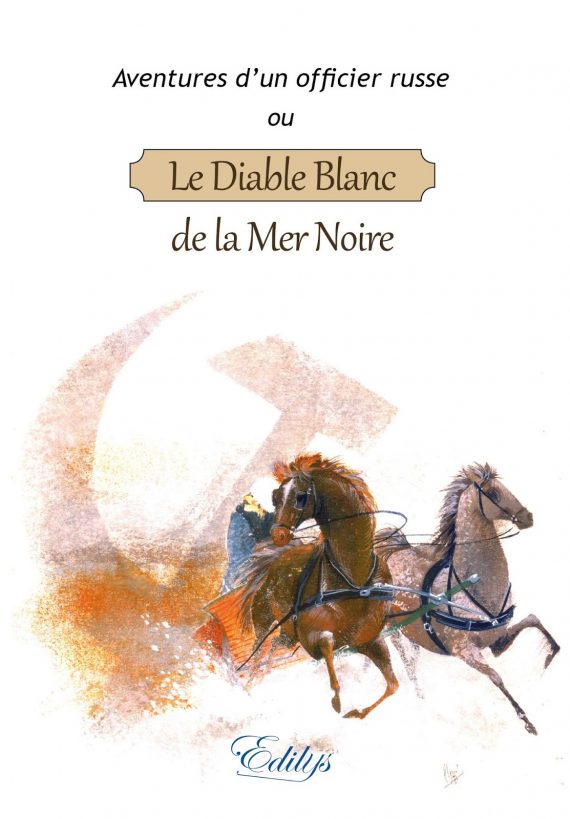
Il y a cent ans, tout juste, la Russie voyait le spectre bolchevique étendre son ombre sur elle. Les journées de mars 1917 inauguraient l’horreur, et un mois plus tard, Lénine, de retour d’exil, présentait au Parti ses thèses révolutionnaires, les Thèses dites d’Avril. C’est à l’orée de ces sombres mois que commence le récit du Diable Blanc de la Mer Noire.
Près de neuf décennies après la première édition, en 1924, l’auteur en reste encore inconnu. Mais il est aisé de croire en sa parole, simple, brève, tellement marquée par cette histoire hallucinante d’un peuple rendu fou par des idées. Sans s’arrêter à l’étude minutieuse et intellectuelle de la contagion rouge dont il voit infesté son peuple, l’officier en montre les effets – ils suffisent largement.
Un récit édifiant qui peut être lu dès 15 ans.
Une odyssée peu commune
Les éditions Edylis ont eu le bon goût de redonner sa place à un titre qui connut entre 1924 et 1964, pas moins de vingt-trois éditions en quatre langues… L’auteur n’était pourtant pas un écrivain de métier. C’est l’éditeur Lewis Stanton Palen, qui le persuada d’écrire ses souvenirs de cette époque : « XXX » mit au clair ses notes – Lewis S. Palen ne les retravailla qu’à peine.
Et le ton est juste, sans exaltation, un témoignage écrit avec la simplicité des braves – certains épisodes font parfois songer à des passages du Soldat Oublié de Guy Sajer, quelques décennies plus tard, sur des fronts tout proches… Réfugié à l’étranger, où l’a rencontré Lewis S. Palen, on peut douter que « le Diable Blanc » ait jamais remis les pieds dans sa sainte Russie, devenue URSS pour quelques décennies – il y aurait été fusillé sans autre forme de procès.
Qui était-ce ? On devrait pouvoir aujourd’hui retrouver son nom, mais au prix de quelques recherches poussées. Lewis S. Palen en donne dans son introduction quelques éléments biographiques. Un père colonel dans l’Armée et écuyer du Tsar, une famille issue de la noblesse, l’officier casse-cou, au tempérament en tout point russe, avait été promu chef de bataillon en janvier 1917 : il ne se doutait pas que ses ennemis allaient être russes.
« Toravitch ! » (Camarade!)
Et, comme il l’écrit lui-même, « la guerre civile est une chose affreuse »… Tous les ingrédients d’un bon roman d’aventure sont réunis : complot, bagarre, espionnage (l’épisode de la fabrique de vodka explosée par l’officier, où se rue tout un peuple obnubilé par l’alcool interdit, est ubuesque). Mais le ton est grave, la réalité est tout sauf réjouissante.
Trois ans de sa vie qu’il raconte, sous l’instauration de la dictature marxiste-léniniste.
Le froid immense de l’hiver qui sévit sur les sotnias des Cosaques. La fuite à travers les steppes des Tartares. La présence diabolique de la Tchéka, à Moscou, qui pousse à se méfier de ses propres amis. L’horreur d’entendre torturer les siens. L’incertitude de pouvoir encore passer les frontières.
L’embarquement, enfin, en novembre 1919, à Yalta, alors que les armées Denikine et Wrangel sont tenues en échec : les derniers restes d’une société russe éperdue, mêlant paysans et officiers, se réfugieront sur des navires anglais…
« Nous sentions que tout était fini en Russie »
« Nous sentions que tout était fini en Russie et qu’un abîme s’était ouvert entre le passé et l’avenir ». Page après page, on voit se dessiner la réalité dévorante de la Révolution. Dès le début de l’année 1918, « les seules personnes pouvant jouir de la liberté et de la vie à Moscou étaient celles qui n’avaient ni le respect de soi, ni le courage de leurs opinions ».
Et cette vérité persista, sous la houlette des « commissaires bolchéviques », qui ne payaient pas leur café au motif que tout devait appartenir au peuple…
L’infestation idéologique toucha particulièrement l’armée de l’empire qui se retrouva très vite parfaitement désorganisée par l’Ordre du jour n°1 lancé par Kerensky qui destituait les officiers (il fallait détruire l’ancienne armée sous peine de voir la révolution écrasée). Quasi du jour au lendemain, revinrent du front des centaines de milliers d’hommes avinés à qui on avait promis les terres des uns et l’argent des autres, s’ils quittaient leurs officiers : on imagine sans peine leur état d’esprit.
Face à eux, une noblesse russe départie de tous ses biens, tant immobiliers que pécuniaires. L’auteur évoque ses hommes, des officiers de l’Armée blanche : « L’un avait eu ses propriétés confisquées ou détruites et était réduit à la pauvreté, un autre sa mère ou sa sœur emprisonnées, un troisième son père fusillé, un autre son frère assassiné, et tout cela pendant qu’ils exposaient bravement leur vie en essayant de préserver l’Armée russe contre l’influence démoralisante de la propagande allemande et révolutionnaire. Le désespoir régnait dans leur cœur et s’exprimait de toutes les façons imaginables ».
Le père face au fils : blanc contre rouge
Une extrême débandade. Quelle force violente que la Révolution… Et que les hommes prennent vite part à ce qui doit, in fine, les ruiner, jusque dans leurs familles !
Le « Diable Blanc » se remémore cette scène restée gravée dans son esprit : un petit vieux rabougri et ramassé par les ans, corrigeant par le fouet sur le pas de sa porte, un grand et jeune Cosaque impassible, de retour du front. Le fort gaillard était son fils, mais il avait déserté, acquis aux idées de la Révolution, et son père le reniait, fidèle aux valeurs du passé.
Un abîme entre deux générations, entre deux ères historiques. « A ce moment où disparaissaient peu à peu tous les vestiges de l’ancienne autorité établie, j’ai vu des choses que je n’ai pas le cœur de raconter, pas plus sans doute que le lecteur n’aurait le cœur de les lire ».
Mais pourquoi « le Diable blanc de la Mer Noire » ?
Mais pourquoi « le Diable blanc » ? C’est l’épithète dont il avait été affublé par les Bolcheviks, à cause de ses manières musclées de défendre le quartier du port de Yalta, quand toute la Crimée se vidait de l’Armée Blanche houspillée par les Rouges.
« Ce surnom me resta tout le temps de mon séjour sur les bords de la Mer Noire. Une forte somme d’argent fut promise à quiconque apporterait à un commissaire la tête du Diable Blanc ».
Vaincu par tant d’injustice, l’officier a rendu coup pour coup.
Il l’explique, ailleurs : « Toutes ces exécutions d’innocents qui ont eu lieu presque en face de moi, tout ce que j’ai vu et enduré moi-même ont fait naître en moi un profond sentiment de vengeance qui, plus tard, m’a conduit à commettre des actes que, sans cela, j’aurais condamnés si d’autres les avaient commis. »
Clémentine Jallais
A lire également, la quasi suite de ce récit, au niveau historique, écrit par Boris Solonévich : Un Chef scout dans la tempête bolchevique (réédition Edilys 2015)











