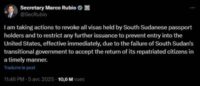La hausse des crimes et délits liés à l’immigration en France et le refus de l’Algérie d’accueillir ses ressortissants en OQTF stimule l’imagination des spécialistes de la subversion, dont l’écologisme est devenu un moyen revendiqué sans masque. Notre confrère d’extrême-gauche Reporterre publie dans cet esprit une inénarrable chronique où la France se trouve accusée d’avoir « détruit la nature » durant la période coloniale, chronique qui estime souhaitable de réduire « l’angle mort de la recherche » qu’est l’étude de l’« écocide lié à la colonisation » dont « l’ampleur reste à quantifier ». Sous la pompe prétentieuse des mots, voilà une simple négation des faits, saupoudrée de déclarations de quelques historiens orientés. Cette démarche est caractéristique, sous le drapeau de la convergence des luttes, de la synergie des subversions (ici environnementalisme et décolonialisme) au sein de la révolution arc-en-ciel.
La France n’a rien volé en Algérie, elle a apporté la prospérité
Le chapô de l’article de Reporter énonce : « L’accaparement colonial de la terre en Algérie a détruit des modes d’organisation et de gestion de la terre en commun. Le développement des monocultures et d’une agriculture d’exportation a aussi bouleversé l’environnement. » La thèse est si générale qu’elle n’est pas absolument fausse, mais le choix du vocabulaire (« accaparement, bouleversé ») suggère un jugement négatif sur l’action coloniale. Plus loin d’ailleurs deux accusations sont clairement portées : la France, en colonisant, a fait des « dégâts sur la nature », elle a « foulé aux pieds » la propriété des Algériens. Or les deux sont injustes. En premier il n’y a pas eu « accaparement » de la terre algérienne. En 1950, seuls 27 % les terres cultivables appartiendront aux colons européens, les 73 % ayant pour propriétaires des Arabes et Kabyles, dont les terres arables auront plus que doublé depuis 1830, grâce à la mise en valeur du pays menée par la France, avec l’assèchements des marais, l’irrigation, la construction de routes, de ponts et de barrages. Sans doute en 1950 la taille moyenne des exploitations indigènes était-elle très inférieure à celle des européennes, mais elle voisinait celle des fermes de la métropole !
La subversion en gros sabots de l’écologisme
La réalité sur quoi la subversion s’appuie pour proférer son mensonge est la suivante. Comme le note Reporterre, la confiscation de terres a été durant la conquête, à partir de 1838 et lors des révoltes, notamment en 1871, un moyen de punir les individus et les tribus qui se dressaient contre la France. Avec, en représailles des razzias menées par les rebelles, des expéditions punitives qui incluaient troupeaux et vergers. Mais une fois soumis, ils ont pu trouver du travail dans l’agriculture et la sylviculture en plein essor lancé par les colons européens. Sisal, vigne, blé, exploitation du chêne liège, etc., ont permis à l’Algérie de nourrir à la fin de la période coloniale une population indigène trois fois plus nombreuse qu’en 1830, tout en dégageant de vigoureuses exportations. Le plus gros des terres des colons européens n’a pas été « accaparé » mais gagné sur des secteurs arides grâce à irrigation ou sur des marécages grâce à leur assèchement.
Reporterre le reconnaît naïvement, les plantations d’eucalyptus ont permis d’éradiquer le paludisme qui « décimait des colons » (et les autres). Une « spécialiste » est citée pour s’en plaindre : « Dans certains endroits, cela a asséché plus qu’il était nécessaire, au détriment d’autres espèces endémiques. »
Mettre en valeur un pays, c’est toucher à ses écosystèmes
En effet, assécher des marais modifie l’environnement. Ici commence l’accusation d’écocide. Les barrages aussi sont condamnés, et en général la « maîtrise des cours d’eau ». A cause de l’inégalité sociale qu’elle est censée induire : « Lorsqu’une source en eau est maîtrisée, elle l’est uniquement au bénéfice des colons, et donc au détriment des agriculteurs algériens qui en sont de fait dépossédés. » Comme si l’irrigation n’avait pas profité aussi aux paysans musulmans ! Mais il y a pire : « C’est toute une série d’éléments liés à la colonisation qui vont contribuer à dégrader l’environnement algérien. En asséchant les sols via la déforestation, l’Etat colonial a par exemple favorisé l’érosion des sols. » Là, on entre quasiment dans le domaine psychiatrique. On aimerait savoir en quoi l’assèchement d’un marais contribue à l’érosion des sols ! Mais rien n’arrête Reporterre.
Citant l’attribution d’une concession de mille hectares de chêne liège pour l’exploitation du liège, il écrit : « Difficile de donner un chiffre précis, mais cet accaparement de ressources essentielles n’a pas été sans conséquences sur l’écosystème algérien. » La rédactrice du passage prépare-t-elle une thèse sur Ecocide et démasclage ? L’écocide en Algérie ? Le progrès apporté par la France !
Cela dit, on tombera d’accord avec Alain Ruscio, autre historien spécialiste convoqué par Reporterre, lorsqu’il affirme que « la totalité de l’écosystème algérien a été affectée par la colonisation ». Quand on tire une région inculte et misérable de sa pauvreté et de son insalubrité, quand on en fait une province prospère et heureuse (Hocine Aït Ahmed, chef historique du FLN, revenant après trente ans d’indépendance à Oran, ravagée par l’incurie du gouvernement algérien qui disposait pourtant de la rente du pétrole découvert par la France, dira : « Ici, avant, c’était le paradis »), on ne peut le faire sans tracer des routes et des voies de chemin de fer, toutes sortes d’infrastructures bénéfiques, sans irriguer grâce à des barrages, sans assécher des nids de malaria et de choléra. Il ne s’agit pas d’idéaliser la colonisation de l’Algérie : de graves inégalités subsistaient. Mais ce qui est dénoncé sous le nom d’écocide, c’est le progrès et le développement d’une région passée de la misère à la civilisation. L’écologisme n’est pas qu’un moyen de subversion, c’est une véritable maladie mentale qui inverse la perception de la réalité.