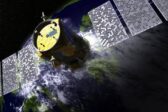La frustration ? Tout le monde connaît. Mais, à lire cet article récent du National Geographic, tout le monde ne semble pas savoir qu’elle puisse être un réel moyen d’apprentissage, qu’on puisse, tout en la prenant en compte, y opposer une réaction salutaire et en tirer par conséquent un apport positif dans la construction de soi et dans son agir. Et cela vaut évidemment à tous les étages, que ce soit celui du corps, de l’esprit ou encore de l’âme : contraindre son corps, réguler ses émotions, accepter la lutte spirituelle.
Il faut dire que la société moderne a précisément mis à mal cet exercice salutaire et nécessaire du contrôle de soi dans l’acceptation du manque ou de l’obstacle. D’abord et avant tout parce que c’est un effort et que notre monde mercantile flatte exclusivement les pentes faciles de l’homme consommateur, en le gavant. Et puis parce que cet effort, greffé sur une insatisfaction, revêt une charge morale profonde. C’est en prétendant combler les hommes que Mai 68 et avant lui la Révolution a volontairement flatté les appétits de tous ordres, renversé le sens de l’autorité et du devoir, ruiné les familles et chassé le règne social du Christ.
Mais les professeurs ne se sont jamais autant plaints du comportement de leurs élèves dont le niveau scolaire ne fait que baisser (car tout est lié). Pire : un certain nombre de parents se révèlent désormais à l’image de leurs enfants.
Et surtout, la frustration est à son comble.
Les règne des émotions – le règne du corps
La frustration est une réalité très concrète, comme le rappelle le National Geographic. « Lorsqu’un objectif est inatteignable, le cerveau réagit comme s’il se trouvait face à une menace. L’amygdale détecte le problème et le signale à l’hypothalamus pour activer une réaction de type combat-fuite qui inonde le corps de cortisol et d’autres hormones du stress. Parallèlement, l’activité du cortex préfrontal, la région qui contribue à la régulation des émotions et à la planification, a tendance à s’inhiber, ce qui nous rend plus impulsifs ou irritables. »
Il y avait une attente qui se retrouve dépourvue de récompense. Baisse de la dopamine, taux potentiellement élevés de cortisol… Un certain nombre d’effets négatifs peuvent s’ensuivre, retombant sur soi ou sur les autres (c’est la principale émotion éprouvée au travail).
Mais à condition de leur donner suite ! Car, si les émotions nous envahissent indépendamment de notre volonté, nous pouvons faire en sorte de ne pas en subir toutes les fâcheuses conséquences, et, au contraire, nous servir d’elles, en tirer parti. C’est ce que développent plusieurs études : voir dans la frustration « un puissant outil pour s’épanouir, apprendre et s’améliorer ».
La frustration est le moteur de l’éducation
Comme le note une dame professeur distinguée de l’Université de Chicago citée par le magazine, la frustration « est fondamentalement l’émotion qui signale que les choses ne progressent pas comme prévu, c’est un retour d’information qui invite à réévaluer ses objectifs et à se demander si l’on devrait procéder autrement ». Non seulement cela habitue à la persévérance, mais cela peut devenir source de créativité et d’innovation.
Et comment y arriver ? D’abord en prenant conscience de la permanence de la frustration, affirme le National Geographic (beaucoup semblent donc avoir oublié qu’elle est inéluctable). Et en changeant de perspective : voir dans la difficulté la possibilité d’un progrès. Réguler son émotion de manière constructive, sans pour autant la faire disparaître, car ce serait gommer la possibilité d’une leçon.
Si tout ceci est parfaitement vrai, plane une légère impression de voir enfoncée une porte ouverte. La conscience de la nécessité de l’apprentissage de la frustration pour la vie en société (notamment dans l’éducation) et l’élévation de soi-même devrait être une évidence. N’est-ce pas le premier écueil auquel est confronté le petit enfant ? La frustration qu’il éprouve à devoir rester immobile, à ne pas atteindre les choses, va le pousser à se déplacer, puis à marcher. Elle va devenir aussi un obstacle de taille pour son premier éducateur.
Seulement le monde s’est déshabitué à accepter que cette donnée puisse être néfaste. A tel point que de très nombreux enfants ont été et sont élevés sans apprendre à gérer leur insatisfaction. Ce qui a mécaniquement engendré des adultes impatients, agressifs, qui ne supportent aucune limite à leur volonté de toute-puissance.
L’anti-modèle du « no limit »
Un directeur général d’un groupe d’écoles au Royaume-Uni, Sir John Townsley, notait, il y a deux jours, dans un article du Telegraph, un point intéressant. « Ces dix dernières années, quelque chose a changé », affirme -t-il, lui qui a déjà passé près de quatre décennies dans le milieu éducatif. Et ce changement réside pour lui dans l’arrivée en tant que parents d’élèves, d’une certaine génération, née à la fin des années 1980 et au début des années 1990, autrement dit celle des Millennials : « Leur arrivée a coïncidé avec des changements radicaux dans la discipline familiale et scolaire. »
Non seulement les enfants n’ont jamais autant manifesté de comportements dits « inappropriés », mais un certain nombre de parents affichent une attitude délétère jamais vue auparavant : ils partent du principe intangible que leur enfant ne peut rien faire de mal, ils se plaignent constamment, attaquent en justice… Pour lui, c’est certain, c’est qu’ils font partie de la première génération à avoir échappé à un modèle éducatif pourvu d’une certaine sévérité, imposant des limites, qu’elles soient physiques, intellectuelles ou morales à leur volonté d’autosatisfaction.
Pour les enfants défavorisés dont la vie familiale est marquée par les privations, continue le directeur, c’est une double peine : ils obtiennent, d’expérience, de mauvais résultats disproportionnés lorsque les normes de comportement sont mauvaises. Et que donneront les résultats pour la génération Z, née pour une bonne part avec un smartphone dans les mains, chez qui l’ingurgitation-saturation des réseaux sociaux a manipulé le circuit de la récompense et imposé la domination des hormones et donc des passions ?
La frustration n’a jamais été si mal traitée.