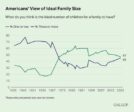Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les jeunes d’origine immigrée les moins bien intégrés dans leur environnement occidental qui présentent le plus grand risque de « radicalisation », mais au contraire ceux qui ont vécu à la manière occidentale, éventuellement issus de familles aisées. C’est l’avis d’une ethnographe néerlandaise, Marion van San, qui devait témoigner ce lundi devant la commission « radicalisation » du Parlement flamand de ses recherches au sein de familles belges ou néerlandaises qui ont vu un enfant partir pour se battre en Syrie. Elle va même jusqu’à dire que ce sont « les jeunes les mieux intégrés qui se radicalisent », elle qui suit le problème sur le terrain depuis 2009. Elle a publié une tribune dans le quotidien belge De Standaard à l’occasion de son audition.
A l’heure où les gouvernements occidentaux aux prises avec la fascination de leurs jeunes « ethniques » (et quelques autres) par rapport à l’islam imaginent trouver une solution dans l’intégration laïciste, le constat de Marion van San mérite d’être entendu. Elle ne craint pas de dire que ce ne sont pas des jeunes de milieux pauvres, qui ont pratiquement lâché l’école avant l’adolescence, ou qui se sentent exclus de la société, qui fournissent les plus gros bataillons des recrues étrangères de l’Etat islamique. Ils sont nombreux à provenir des « classes moyennes ou aisées ».
Les stéréotypes de la radicalisation
Et de combattre quelques « stéréotypes ». En Flandres, on a tendance à croire que les candidats au djihad en Syrie proviennent d’environnements socio-économiques défavorisés. Faux, dit Marion van San. « Que les jeunes qui prennent le chemin de la Syrie depuis l’Europe soient les victimes d’une société qui ne les accepte pas et où ils n’ont pas de chances de réussir est démenti par les faits. »
Ils ne sont pas non plus mal « intégrés », assure-t-elle. Il s’agit souvent de jeunes qui sont fortement tournés vers la société belge : des jeunes qui sortaient, qui buvaient de l’école – souvent consommateurs de « drogues douces »…
Notons-le au passage : si l’intégration, c’est ça, on comprend qu’elle ne puisse pas combler une soif d’absolu, pour dévoyée qu’elle soit.
Souvent, aussi ils ont un diplôme de fin d’étudesv ; leurs cercles d’amis sont « ethniquement diversifiés ».
Intégrés sans l’être, les jeunes se tournent vers l’aventure de l’Etat islamique
« Ils sont assoiffés de reconnaissance sociale et font tout ce qu’ils peuvent pour s’intégrer. Il s’ensuit qu’ils ont des attentes sociales plus fortes et qu’ils sont plus sensibles à l’exclusion et une (supposée) discrimination. Une expérience négative peut les pousser à se détourner de la société et à chercher leur salut dans le cadre d’une identité de groupe déviante » : pour la chercheuse, cette « discrimination » est loin d’être établie, elle n’en a pas rencontré de nombreux exemples sur le terrain. Pas plus qu’elle n’a dressé le portrait de jeunes « radicalisés » parce qu’ils se sentent « frustrés » dans leur environnement occidental. Mais ces jeunes, enfants ou petits-enfants d’immigrés, sont nés et ont grandi « ici » et se montrent beaucoup plus susceptibles.
Marion van San est en relation étroite avec quelque 90 familles dont l’un des enfants a fait le voyage de Syrie depuis 2009 – aujourd’hui pour rejoindre l’Etat islamique. Ce sont des familles très « diverses » mais souvent « harmonieuses », note l’ethnographe : des familles où les parents ont essayé, en vain, de retenir leur enfant et de faire abandonner ses nouvelles convictions. Sa « conversion », même, puisque généralement il s’agit d’un jeune qui a goûté à la culture occidentale – dans ce qu’elle a de pire, faudrait-il ajouter pour compléter le propos de la chercheuse.
Ne pas chercher à « intégrer » pour mettre un terme à la radicalisation
En ne tenant pas compte de ses constats, avertit en tout cas Marion van San, en imaginant que l’« intégration » accrue va régler le problème de la radicalisation, on se trompe. Ce sont des solutions illusoires. « Je ne plaide pas pour qu’on touche aux fondements de la politique contre la pauvreté ou pour qu’on cesse de s’occuper de la discrimination, bien réelle, sur le marché du travail. Mais il ne faut pas se bercer d’illusions : ce ne sont pas ces mesures-là qui contreront le radicalisme et l’extrémisme. »
Alors quoi ? Marion van San ne donne pas la réponse. On pourrait cependant en ébaucher une, à partir même de son expérience.
D’abord, ces jeunes apparemment si bien « intégrés » qui choisissent la radicalisation, le djihad, l’Etat islamique… sont des déracinés. Ils vivent au milieu d’une culture qui n’est pas la leur et qu’ils ont adoptée dans ses travers et ses décadences plutôt que dans les richesses qu’elle aurait pu leur apporter. Richesses immatérielles, s’entend : une foi, une civilisation, une exigence bienfaisante qu’elle est largement incapable de transmettre faute de croire en elle-même.
« Intégration » à l’Occident décadent
Ils sortent, ils boivent, ils se droguent : amusements de gosses de riches, finalement, en ce sens que ces « divertissements » détournent leurs habitués du sens du travail, de l’effort, et plus encore des réalités les plus profondes. On peut, avec Marion van San, appeler cela de l’intégration. Et si c’était de la désintégration ?
Face à ce vide entretenu soigneusement par un enseignement laïc et un relativisme de rigueur, la rébellion n’est pas si étonnante. Et les prédicateurs de l’islam, du djihad, savent sans aucun doute jouer sur ce sentiment et sur ce manque d’absolu.
Le plus urgent, face à la tentation de l’islam viril et conquérant, est sans nul doute de retrouver la véritable identité de l’Occident. Qui n’est pas une identité « racialiste » ou « ethnodifférenciée » : c’est un amour de la vérité et du bien qu’il nous appartient de faire découvrir – la seule « intégration » qui vaille.