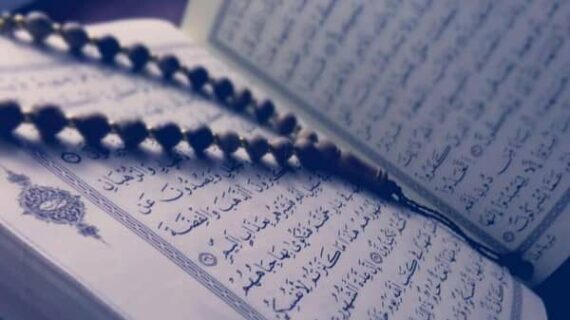L’institut français d’opinion publique, IFOP, a publié le 18 novembre une importante étude intitulée Etat des lieux du rapport à l’islam et à l’islamisme des musulmans, menée tant auprès des musulmans vivant en France que des fidèles d’autres religions et des athées. Elle est capitale à deux titres, parce qu’elle a été faite avec un grand soin, sur un échantillon étendu, et parce que les commentaires qui l’accompagnent sont marqués par la mesure, et même par la volonté de minimiser les conséquences du phénomène mis à jour par les données. Celui-ci en saute d’autant plus aux yeux : la progression numérique de l’islam explose, d’une part ; et de l’autre, si l’on se réfère à un passé encore récent, les convictions religieuses, les pratiques sociales, les certitudes juridiques et politiques des fidèles de l’islam en France sont plus fermes, plus affichées, revendiquées. Qu’il s’agisse de charia, de ramadan, de viande halal ou de soutien aux frères musulmans. En outre, c’est particulièrement flagrant chez la jeunesse, qui se radicalise.
Multiplié par 14, l’islam explose en France selon l’IFOP
Première donnée, de fait. Selon l’IFOP, « la proportion de musulmans au sein de la population française adulte est passée de 0,5 % en 1985 à 7 % en 2025, faisant de l’islam la deuxième religion de France après le catholicisme (43 %) mais devant le protestantisme (4 %) ». Pour François Kraus, directeur du pôle « Politique/Actualités » de l’IFOP, qui exprime le point de vue de l’IFOP, « les résultats de cette étude ne vont pas dans le sens des chantres du “Grand remplacement” qui assènent depuis des années l’idée d’une présence massive des musulmans en France ». Cette affirmation, à la fois polémique et modératrice, se fonde sur la revendication d’une supériorité technique. L’enquête IFOP « repose sur un échantillon plus exhaustif que l’enquête TEO (INED-INSEE 2019-2020) et plus robuste que l’EVS (2018) ». Admettons par souci de méthode le chiffre de l’IFOP : en moins de 40 ans, la proportion de musulmans dans la population de France aurait été multipliée par 14 : c’est nettement plus, et six fois plus vite, que l’ensemble des grandes invasions du troisième siècle au début du sixième. En outre, la religion n’est pas la seule mesure de l’invasion, et le test de drépanocytose montre, par exemple, que plus d’un tiers des naissances en France ont au moins un parent venu du « Sud ». Tout cela montre que le commentaire IFOP entend minimiser la migration en cours.
Progression fulgurante de l’islam régressif chez les jeunes
Cela n’en donne que plus de force à la suite de l’étude. Non seulement l’islam explose en France, mais ce n’est plus le même islam, c’est un islam qui se revendique plus islamique que l’islam d’il y a quarante ans, et plus musulman que les catholiques, par exemple, ne se revendiquent catholiques. Ainsi 80 % des musulmans de France (87 % chez les jeunes de 15 à 24 ans) se déclarent-ils religieux, contre 48 % des fidèles des autres religions. Près d’un quart des musulmans (24 %) se dit « très religieux » contre 12 % des autres fidèles. Pour l’IFOP, ce renforcement de la religiosité s’inscrit avant tout dans un processus de « réaffiliation religieuse » d’une partie de la jeunesse musulmane à un islam traditionaliste. Et de parler de « réislamisation » en citant quelques chiffres (il y en a d’autres) : « La fréquentation hebdomadaire de la mosquée qui est passée de 16 % en 1989 à 35 % en 2025, la pratique quotidienne de la prière a augmenté entre 1989 (41 %) et 2025 (62 %), atteignant elle aussi des sommets chez les jeunes de moins de 25 ans : 67 %. » Quant au jeûne du Ramadan, 73 % des musulmans de France (83 % chez les jeunes) l’observent pendant tout le mois (contre 60 % en 1989). Idem pour la consommation d’alcool, elle est tombée de 35 % en 1989 à 21 % en 2025 et 12 % chez les jeunes.
Selon l’étude, la jeunesse se radicalise sur le sexe
Cette stricte observance des règles religieuses de l’islam entraîne celle des règles sociales. Là encore les jeunes sont en pointe. Si un petit tiers seulement (31 %) des musulmanes se voilent, les 18-24 ans sont 46 % à le faire, soit trois fois plus qu’en 2003 (16 %), année du débat sur l’interdiction du voile à l’école publique. Symétriquement, 43 % des musulmans refusent au moins une forme de contact physique ou visuel avec l’autre sexe. Un sur trois (33 %) refuse de faire la bise, 20 % refusent d’aller dans une piscine mixte, 14 % de serrer la main à une femme et 6 % de se faire soigner par un médecin femme. Laissons la parole à l’inénarrable langue de bois de l’IFOP : « Le rejet de ces formes de contact physique ou visuel avec l’autre sexe témoigne, comme le port du voile, d’un “séparatisme de genre” passant avant tout par l’invisibilisation du corps féminin et une rigidification des rapports hommes-femmes. Portées par la frange la plus rigoriste de la population musulmane, ces pratiques s’inscrivent probablement dans une dynamique de réaffirmation identitaire où elles fonctionnent comme des marqueurs de distinction dans une société perçue comme hostile ou assimilatrice. Mais ce rejet de la mixité apparaît aussi en opposition totale avec le libéralisme des mœurs dominant en Occident et les valeurs d’égalité et de mixité promues par la République. »
L’islam se pose en contre-société en France
Ainsi le fidèle de l’islam en France entend-il vivre en islam, penser en islamique, sous la loi islamique, et a-t-il de la sympathie pour l’islamisme. 65 % des musulmans pensant que « c’est plutôt la religion qui a raison » que la science sur la question de la création du monde, soit plus de trois fois plus que dans les autres religions (19 %). D’autre part, 46 % des musulmans estiment que la loi islamique doit être appliquée dans les pays où ils vivent, dont 15 % « intégralement quel que soit le pays dans lequel on vit » et 31 % « en partie » en l’adaptant aux règles du pays d’accueil. Commentaire de l’IFOP : « La population musulmane se développe dans une logique de “contre-société”, c’est-à-dire qu’elle cherche à organiser sa vie quotidienne selon des normes religieuses distinctes, voire opposées, à celles de la société majoritaire. » Loin de décliner, cette tendance se renforce, « portée par une jeunesse de plus en plus désireuse de marquer son identité musulmane face à une société française perçue comme hostile ».
L’IFOP veut une réponse politique de la France à l’islam radical
Cela se traduit en termes d’identité et de politique. 38 % des musulmans approuvent tout ou partie des positions « islamistes » en 2025, soit deux fois plus qu’en 1998 (19 %). Un musulman sur trois (33 %) affiche de la sympathie pour au moins une mouvance islamiste, dont 24 % pour les Frères musulmans, 9 % pour le salafisme, 8 % pour le wahhabisme, 8 % pour le Tabligh, 6 % pour le Takfir et 3 % pour le djihadisme. Un jeune sur trois (32 %) se dit proche du courant de pensée des Frères musulmans. Ce qui entraîne l’IFOP à conclure sous la plume de François Kraus : « Cette enquête dessine très nettement le portrait d’une population musulmane traversée par un processus de réislamisation, structurée autour de normes religieuses rigoristes et tentée de plus en plus par un projet politique islamiste. (…) Reste à savoir si cette dynamique est réversible. L’enquête suggère qu’à ce stade, rien ne semble enrayer ce processus de réislamisation. Au contraire, tous les indicateurs convergent vers un renforcement de ces tendances dans les années à venir. Dans ce contexte, la question de l’intégration des musulmans de France et de leur adhésion aux valeurs républicaines se pose avec une acuité nouvelle, appelant des réponses politiques qui dépassent largement les seules approches sécuritaires ou répressives. »