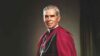C’est l’un des plus grands cabinets de conseil en stratégie mondiale. McKinsey & Company s’est toujours déclaré un acteur proactif de la transition énergétique, soutenant explicitement l’Accord de Paris et les Objectifs de développement durable de l’ONU, prônant une « croissance durable et inclusive » et invitant ses clients à faire de même. Pourtant, la dixième édition de son étude « Global Energy Perspective » parue à la mi-octobre, marque le plus grand revirement qu’il lui ait jamais été donné de faire dans ce vert domaine : il reconnaît que le charbon, le pétrole et le gaz naturel resteront les principales sources d’énergie mondiale bien au-delà de 2050.
Traduisez : les politiques environnementalistes ne suffisent décidément pas à fournir une énergie bon marché et une sécurité d’approvisionnement. Ainsi, est proclamée par un nom bien en place dans la sphère mondialiste, une évidence serinée depuis des années par ceux qu’on nomme, avec dédain, « climatosceptiques » !
La doxa écologique ne peut pas décider de tout. La réalité d’un monde où les pays en développement comme la Chine ou l’Inde s’industrialisent à vitesse grand V et où la demande en électricité croît comme jamais avec les besoins des centres de données et bientôt de l’IA, nécessite qu’on soit humble et réaliste : les nouvelles technologies à faibles émissions ne font pas le poids. Pire, elles sont, dans le contexte qui est le nôtre, abhorrant le nucléaire, fondamentalement inadaptées.
McKinsey soutient la transformation bas-carbone mais revient (un peu) à la raison sur le pétrole
Selon le rapport, quasiment tous les pays ont adapté leurs impératifs de décarbonation dans leurs politiques énergétiques. Et les projections, bien sûr, s’en ressentent. L’année dernière, les modèles du cabinet de conseil tablaient sur une chute de 40 % de la demande de charbon d’ici à 2035. Aujourd’hui, McKinsey prévoit une hausse de 1 % sur la même période !
Plus globalement, le rapport indique que les trois combustibles fossiles fourniront encore jusqu’à 55 % de l’énergie mondiale en 2050. Et qu’elles représenteront une part importante de la consommation « bien au-delà de 2050 ». Le scientifique Vijay Jayaraj, dans The Daily Caller, pense que ces prévisions sont encore bien sous-estimées. Par comparaison, la part des hydrocarbures dépasse aujourd’hui 60 % pour la production d’électricité et plus de 80 % pour la consommation d’énergie primaire.
Les trois priorités d’un système énergétique fonctionnel et pérenne, à savoir l’accessibilité financière, la fiabilité et la durabilité, sont trop remises en cause par l’utilisation excessive des énergies dites vertes. « Premièrement, la compétitivité des coûts et une transition énergétique économiquement pragmatique demeurent primordiales », dit le rapport. Il ajoute : « Deuxièmement, il n’existe pas de solution miracle pour la décarbonation. Les pays et les régions suivront des trajectoires distinctes en fonction de leur situation économique locale, de leurs ressources et des réalités propres à chaque secteur. »
Autrement dit, chacun y va à sa sauce et à son rythme. Et McKinsey l’admet sans tiquer.
Le paysage de la transition énergétique est redessiné
L’ONU veut mettre Gaïa, la Terre Mère, au vert. De nombreux pays préfèrent, eux, la sécurité de leurs terres et des peuples qui les habitent. Face à l’idéologie consciemment irresponsable se dresse le réalisme prudemment pragmatique.
Dans des régions comme l’Inde, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique subsaharienne, note Vijay Jayaraj, c’est tout simplement une question de sécurité nationale. Les dirigeants savent parfaitement qu’une dépendance exclusive à une énergie soumise aux aléas climatiques risque d’entraîner des coupures de courant, des perturbations industrielles, un déclin économique et des troubles sociaux. Et ce, malgré toutes les subventions possibles des organes mondialistes. C’est pourquoi, ces pays, en pleine expansion industrielle, choisissent de poursuivre leurs investissements dans la production d’électricité conventionnelle (charbon, gaz, nucléaire) tout en développant des technologies alternatives.
Quelque part, le cabinet est bien forcé de reconnaître une réalité qui crève les yeux. La Chine, par exemple, a approuvé la construction de 25 GW de nouvelles centrales à charbon au cours du premier semestre 2025, une mise en service record portant le total de ses centrales à près de 1.200. Les combustibles fossiles restent très majoritaires pour des secteurs comme la sidérurgie, la chimie et l’industrie lourde. Et la consommation mondiale d’électricité augmente de façon importante, ce qui s’explique, en particulier, par la demande des centres de données : le rapport parle d’une croissance de 17 % par an entre 2022 et 2030 dans les 38 pays de l’OCDE.
L’accès à une énergie fiable demeure le fondement de la civilisation moderne
McKinsey le dit à mots couverts : on ne peut construire une économie solide sur des sources d’énergie intermittentes et dépendantes des conditions météorologiques, comme l’éolien et le solaire. Ces énergies qu’on qualifie de renouvelables devraient être plutôt considérées comme des freins à l’économie. On l’a vu en Espagne.
Il suffit de regarder l’Allemagne, exemple européen criant, qui a dépensé des milliards pour se mettre au vert et démantelé toutes ses centrales nucléaires et la plupart de celles à charbon. Résultat, le pays est confronté à une inflation élevée et à une stagnation économique. Les Allemands ont même maintenant un mot pour définir ces fameuses périodes où le réseau électrique, ultra « green », est défaillant, parce qu’il n’y a pas assez de soleil et (ou) pas assez vent : « Dunkelflaute », qu’on peut traduire par « calme sombre ». Car il faut alors recourir aux énergies fossiles et les prix augmentent…
Vijay Jayaraj de The Daily Caller rit jaune quand même de lire ces tranquilles affirmations qu’on aurait dit « partisanes » dans la bouche d’un think thank de droite. Depuis combien de temps, des scientifiques, des économistes honnêtes et avertis le clament ? Mais qu’on se rassure, McKinsey n’ira pas plus loin. Si la réalité (ainsi que ses gros clients pétroliers) l’a obligé à un certain retour au réel, il n’en reste pas moins coi sur les ravages qu’ont déjà causés ces politiques vertes, en termes de pertes d’emplois, de liquidations d’entreprises, d’appauvrissements multiples et variés…
La statue climatique n’est pas déboulonnée pour autant.