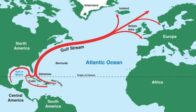Voilà de quoi écorner le récit usuel ou plutôt le poncif du réchauffement climatique sur l’inexorable fonte des glaces : celles de l’Antarctique ont gagné en étendue pour la première fois depuis des décennies ! C’est une étude chinoise très officielle qui l’affirme, appuyée sur des chiffres marquants repris par la presse scientifique qui doit bien s’en accommoder. Elle s’en tire à bon compte en avertissant, sans aucune preuve pour le coup, que ce n’est qu’une bonne nouvelle temporaire pour le climat. Pendant ce temps-là, on sourit… Depuis combien de temps n’entend-on pas dire que la fonte des glaces de l’Antarctique constituait une menace irréversible qui allait bientôt inonder les villes côtières et condamner les générations futures ?
Comme le note le média en ligne TFPP Wire (The Federalist Papers Project), « la nature, comme d’habitude, est bien plus complexe que les modèles poussés par les bureaucrates mondiaux ». Un peu plus d’humilité, que diable, et surtout un peu moins d’idéologie…
Pleins feux sur l’Antarctique
La question de la calotte glaciaire a toujours été un élément de choix dans le discours de peur inlassablement répété par les chantres du changement climatique. Qui dit fonte, dit élévation du niveau de la mer, dit impact sur les continents : autrement dit, « vous allez tous mourir noyés » si vous n’agissez pas (premier mensonge), si vous ne vous engagez pas pour réduire l’empreinte carbone, cause de la hausse des températures (deuxième mensonge.)
En 2007, on nous affirmait que la calotte glaciaire de l’Arctique allait disparaître. Et l’évolution des années suivantes a apporté de l’eau au moulin de cette perspective : selon les données des missions GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) qui mesurent les variations du champ de gravité de la Terre pour suivre les fluctuations de la masse de glace, la calotte glaciaire de l’Antarctique cette fois-ci (AIS) a perdu de la glace à un rythme de 142 gigatonnes par an entre 2011 et 2020.
Sauf que la situation s’est inversée. Selon la dernière étude publiée dans Science China Earth Sciences, le 19 mars dernier, la calotte glaciaire de l’Antarctique ne diminue plus : elle a même gagné de la masse entre 2021 et 2023 !
Très exactement, l’inlandsis antarctique a gagné environ 108 gigatonnes de glace par an au cours de cette période, inversant ainsi une décennie de pertes antérieures. Une évolution qui est due, en grande partie, à une augmentation inhabituelle des précipitations, en particulier dans l’Antarctique de l’Est. La reprise est d’ailleurs particulièrement prononcée dans les bassins glaciaires de cette région, qu’on considérait comme « déstabilisés ».
Davantage de neige et de glace – et moins d’élévation du niveau de la mer
Ainsi, cette croissance pourrait temporairement compenser l’élévation du niveau de la mer d’environ 0,3 millimètre par an et donc obliger à réévaluer les prévisions à court terme concernant le niveau de la mer. De quoi faire revoir les prédictions alarmistes de la clique climatique, mieux, leur politique, leur financement et toutes les réglementations mondiales afférentes ! Mais les scientifiques tentent déjà de minimiser cette découverte, la qualifiant d’anomalie temporaire et non de tendance à long terme.
Car la tendance à long terme pour le dogme du changement climatique, c’est le bouleversement de la nature par les émissions humaines de carbone : les glaciers doivent fondre, l’élévation du niveau de la mer, c’est à cause de nous.
Et si ce n’était pas le cas ?, se demande le journaliste de TFPP Wire. « Et si ces changements climatiques faisaient partie d’une variabilité naturelle que nous ne comprenons pas entièrement ? Le fait qu’un changement aussi radical puisse se produire aussi rapidement devrait nous rappeler que la science n’est pas aussi bien établie que certains le prétendent. »
La seule tendance vérifiable que l’on observe, comme l’a noté un rapport de mai 2019 du Heartland Institute intitulé « Global Sea-level Rise: An Evaluation of the Data », et évoqué ici sur RiTV, c’est un taux linéaire lent de l’élévation du niveau de la mer depuis les années 1920, sans aucune accélération. Elle ne peut pas être mise en rapport avec l’augmentation des « émissions de CO2 » mondiales qui, elle, n’est pas linéaire du tout et qui est postérieure à la seconde guerre mondiale. Ce qui signifie donc que, même si leur Net Zéro Carbone était atteint (ce qui est impossible dans un avenir proche) il n’aurait qu’une influence dérisoire sur cette élévation…
Pour le reste, c’est cyclique. C’est naturel. C’est loin d’être absolument saisissable et surtout programmable, comme nous le montre la reprise des glaces dans l’Antarctique.
Le CO2 n’est pas le grand responsable du climat
Encore une fois, les climato-alarmistes se servent d’un phénomène dont les experts ne maîtrisent en réalité pas grand-chose pour imposer un programme politique. En imposant la vision et l’adoption de modèles climatiques extrêmes plaqués, et en se servant de l’outil CO2, ils justifient ainsi, par la peur, la restructuration, la réorganisation de l’économie mondiale – et notre appauvrissement et notre asservissement.
Il faut lire les gros titres du New York Times, rien que ces dernières semaines. « Dans 15 ans, 80.000 maisons de la région de New York pourraient être détruites par les inondations », annonce un article du 15 avril, tablant sur une élévation du niveau de la mer d’une dizaine de centimètres en ce temps record… Le lendemain, un éditorial intitulé « Le changement climatique pourrait devenir une catastrophe économique mondiale » projetait un effondrement économique imminent, provoqué par la destruction des marchés immobiliers, de l’accès aux assurances et du PIB mondial, le tout dû au climat.
Non seulement on modélise toujours le pire scénario, en se déconnectant totalement des données empiriques du monde réel, mais, comme le faisait remarquer Antony Watts du média en ligne ClimateRealism, on fait fi de la longue expérience de l’humanité en matière d’adaptation, d’innovation et de résilience face au changement. Cette attitude serait inexplicable sans un objectif idéologique. Le véritable risque pour les systèmes économiques n’est pas le changement climatique, mais ce qu’on veut créer « grâce » à lui.