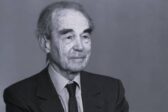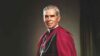L’écrivain anglais du XVIIIe siècle, Samuel Johnson, n’avait pas besoin d’études statistiques ni de recherches psychologiques avancées pour constater que penser à la mort a des conséquences sur le psychisme et l’activité humaine. Son biographe James Boswell lui attribue ce mot d’esprit à propos de l’exécution d’un clerc anglican : « Lorsqu’un homme sait qu’il sera pendu dans quinze jours, cela lui concentre merveilleusement d’esprit. » Voici qu’une enquête menée à l’université d’Arizona vient confirmer cela à sa manière, en indiquant que penser à la mort permet d’obtenir plus facilement le succès.
Ce constat résulte de diverses expériences avec un groupe de joueurs de basket ball : les universitaires ont pu constater qu’ils jouaient mieux dès lors qu’ils avaient pensé à la mort avant d’entrer sur le court. Il s’agit d’une très sérieuse évaluation de la « théorie de la gestion de la peur », développée aux Etats-Unis. Elle part de l’instinct de survie et de la volonté chez l’homme, conscient de sa finitude, de contrer le caractère inéluctable de la mort, à la fois par l’adhésion à une croyance culturellement partagée et par le sentiment qu’on laisse une trace significative dans ce monde « investi de sens », convictions qui détermineraient l’estime de soi. Passablement tirée par les cheveux, la théorie cadre bien avec le matérialisme ambiant, où la religion n’est plus que l’opium du peuple et où l’on explique que l’homme rejette (ou discrimine) celui qui ne pense pas comme soi pour se rassurer.
Penser à la mort, une manière de stimuler son estime de soi ?
Publié dans le Journal of Sport and Exercise Psychology, l’article scientifique ne craint pas d’affirmer que penser à la mort pourrait être utilisé comme un « motivateur puissant », aussi bien dans le domaine du sport que dans toutes les activités où la performance est importante.
En somme, l’idée de la mort pousserait l’individu à chercher à alimenter son estime de soi et à accomplir ce qui lui donne l’idée d’avoir réussi, en vue d’atteindre « l’immortalité symbolique ».
« Votre subconscient cherche à trouver les moyens de vaincre la mort, de faire que la mort ne soit pas un problème et cette solution, c’est l’estime de soi. L’estime de soi vous donne le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, l’idée que vous avez le moyen d’atteindre l’immortalité, que vous avez un sens, que vous n’êtes pas seulement un sac de viande », explique Uri Lifshin, co-responsable de l’étude.
Succès à la vue d’un crâne
En pratique, l’expérience a été conduite en proposant aux joueurs de basket deux questionnaires, l’un parlant de leurs sentiments sur le jeu lui-même, l’autre de leurs pensées à propos de la mort. Ceux qui ont rempli le deuxième questionnaire ont mieux joué que d’habitude : une amélioration de performance évaluée à 40 %.
Une autre expérience faisait jouer la moitié des basketteurs aux tirs au panier sous le regard un chercheur portant un T-shirt avec une tête de mort blanche et affichant d’autres symboles de la mort, tandis que le groupe de contrôle ne voyait qu’un chercheur habillé de manière banale. Ceux du premier groupe ont eu 30 % de plus de réussite que ceux du second.
On pense bien sûr aux tableaux classiques montrant des saints ou des penseurs avec un crâne entre les mains ou sur leur bureau. Mais toute idée de fin dernière, de pénitence, de méditation sur le sens véritable de la vie et sur les manquements à la loi divine a disparu de cette évaluation très moderne qui pousse l’utilitarisme jusque dans ses retranchements les plus extrêmes. Il s’agit de penser à la mort pour avoir une meilleure idée de soi…
Penser à la mort : tout sauf un exercice religieux…
En cette période de commémoraison des fidèles défunts, temps privilégié pour implorer le salut éternel pour soi et pour les autres, c’est un exemple de plus de la banalisation de la mort qui s’installe à grands pas.
On a beaucoup écrit sur l’escamotage de la mort dans les sociétés modernes : aseptisée, refusée, cachée. Cela reste vrai sous certains rapports, mais sous bien d’autres, la mort, mais la mort sans issue, la mort sans lendemain, la mort comme un objet désirable en soi est aujourd’hui omniprésente. Pour les enfants, il y a la fête de Halloween paganisée. Le Death Metal fait vibrer les foules de jeunes Européens à la manière dont les sorciers font danser les peuples barbares. Du jeu vidéo à l’exaltation islamiste de Daech, la mort fait gagner des points. Et pour les vieux, les malades, les « fatigués de vivre », l’euthanasie devient une solution de plus en plus facilement acceptée à travers le monde. La mort comme solution à tout : la « culture de mort » dans le plein sens de ces mots.