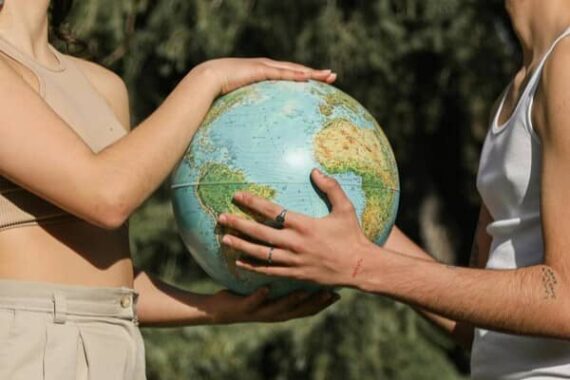Bien connu des internautes espagnols, l’abbé Jesús Maria Silva Castignani est prêtre de paroisse à Madrid mais aussi évangélisateur sur internet, où il porte le message rédempteur du Christ sur les réseaux sociaux et apparaît désormais comme une référence pour ceux qui sont à la recherche de la vérité catholique. Il vient de publier sur Religión en Libertad une intéressante critique de l’« écologie au centre », cette préoccupation désordonnée pour le créé à laquelle même l’Eglise en arrive à participer.
Sous le titre « Quand l’écologie occupe le centre », le P. Silva Castignani analyse les erreurs qui conduisent à inverser l’ordre des choses : ravaler l’homme, seul sur cette terre à être créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, au rang de créature parmi d’autres, oubli de l’Incarnation et de « la vocation de l’être humain à participer à la vie divine », la dérive vers un « panthéisme modéré ou un spiritualisme diffus ». « Dans ce cadre, le péché n’est plus une rupture avec Dieu, mais un dommage écologique ; la conversion se transforme en recyclage ; et le salut en équilibre climatique », déplore le prêtre, et cela se manifeste de manière particulièrement grave, insiste-t-il, dans l’oubli de la nécessité de la Rédemption.
De fait, si l’écologie est au centre, la place du Christ, centre et axe du monde est occupée à tort. La créature remplace le Créateur, c’est la définition même de l’idolâtrie, et en l’occurrence, quand l’auteur parle de « panthéisme modéré » il vaudrait mieux le définir comme un panthéisme à part entière (le panthéisme peut-il être à moitié ?), mais qui ne dit pas son nom !
Le monde moderne met l’écologie pour éliminer la Rédemption
Mais une telle dénonciation d’une erreur aussi grave vaut particulièrement d’être entendue en ce qu’elle émane d’un prêtre diocésain, et que celui-ci tient un discours peu commun parmi nos contemporains, alors même que la question omniprésente et envahissante de l’écologie fait tout pour façonner notre monde… et nous détourner de Dieu, comme le P. Silva l’a bien vu. Elle promeut aussi une politique mondiale qu’il n’évoque pas, pour le coup, ne soulignant pas en quoi l’écologie telle qu’elle s’est répandue aujourd’hui est une subversion et une inversion à part entière, mais cela nous entraînerait trop loin. Chercher d’abord le royaume de Dieu, comme ce prêtre y invite au fond, c’est déjà le bon point de départ.
Soulignons donc que derrière ses tournures parfois très modernes (comme la définition de l’Eglise comme « sacrement universel du salut », utilement critiquée ici), ce texte affirme un point essentiel : le « paradigme » écologique est faux, il détourne l’homme de sa fin et fait oublier la nécessité de la grâce.
Nous vous en proposons ci-dessous la traduction intégrale. – J.S.
*
Quand l’écologie occupe le centre
Au cours des dernières décennies, la sollicitude à l’égard de la maison commune a occupé une place de plus en plus centrale dans le discours ecclésial. Les exhortations, les projets pastoraux et les déclarations qui considèrent l’écologie intégrale comme un paradigme de compréhension du monde et de l’action de l’Eglise se multiplient.
Le risque de faire de l’écologie le point central de la mission chrétienne
Nul ne saurait nier que la sauvegarde de la création est une exigence qui découle de l’Evangile et de l’anthropologie chrétienne elle-même. Cependant, lorsque cette préoccupation devient le principe structurant de la vie ecclésiale et sociale, un risque théologique majeur apparaît : le déplacement de l’axe christologique et sotériologique qui, historiquement, a sous-tendu toute la doctrine sociale de l’Eglise.
De la théologie de la rédemption à la théologie de l’équilibre
Dans la tradition sociale chrétienne, depuis Rerum novarum jusqu’aux documents les plus récents, le centre de la réflexion était non pas l’équilibre écologique, mais la dignité de l’homme racheté par le Christ. Tout l’ordre naturel – la famille, le travail, l’économie, la politique, la culture – était compris à la lumière du mystère de l’Incarnation et de la vocation de l’être humain à participer à la vie divine.
Le point de départ était toujours théologique : le monde est la création de Dieu, et l’homme, fait à son image et à sa ressemblance, reçoit le mandat de dominer et de garder la terre (cf. Gn 1, 28) non pas en tyran, mais en administrateur responsable. Cette administration était orientée vers le salut : la création est un don qui anticipe la plénitude eschatologique dans le Christ, « quand Dieu sera tout en tous » (1 Co 15, 28).
En revanche, une partie du discours contemporain tend à déplacer cet horizon transcendant et à le remplacer par un critère immanent, centré sur la durabilité de l’écosystème ou l’équilibre de la biosphère. La théologie de la rédemption cède le pas à une théologie de l’équilibre, où l’homme n’apparaît plus comme le sujet moral et historique de la création, mais comme un simple élément du système naturel.
De l’anthropocentrisme chrétien à l’éco-anthropocentrisme diffus
La tradition biblique a toujours affirmé un anthropocentrisme théologique, c’est-à-dire une vision de l’homme en tant que sommet de la création et médiateur entre Dieu et le monde visible. Cet anthropocentrisme n’implique pas une domination despotique, mais une responsabilité et une vocation sacerdotale : l’être humain offre le monde à Dieu en louange et le transforme en un lieu de communion.
Lorsque ce centre est remplacé par une « écologie intégrale » comprise comme un système global de relations où tout a la même valeur, la singularité de l’homme s’estompe. De gardien, il devient une espèce parmi d’autres ; de responsable devant Dieu, il devient participant à un cycle naturel qui s’autorégule.
Cette dérive, que l’on pourrait qualifier d’éco-anthropocentrique, peut prendre des accents de panthéisme modéré ou de spiritualisme diffus : la nature est sacrée, la Terre est notre mère, le cosmos s’équilibre de lui-même. Dans ce cadre, le péché n’est plus une rupture avec Dieu, mais un dommage écologique ; la conversion se transforme en recyclage ; et le salut en équilibre climatique.
Il s’agit, au fond, d’une sécularisation du discours théologique, où les catégories de grâce, péché, rédemption et vie éternelle sont remplacées par bien-être, durabilité, harmonie et développement durable. L’Evangile se moralise et perd sa dimension surnaturelle.
La moralisation du message chrétien
Lorsque l’écologie devient le fil conducteur de la mission de l’Eglise, le langage chrétien tend à se moraliser. On parle de responsabilité, d’engagement, de respect, mais on mentionne à peine la grâce ou la vie nouvelle dans le Christ. L’annonce kérygmatique cède la place à un discours éthico-humanitaire.
Le problème ne réside pas dans le contenu – car prendre soin de la création est une conséquence légitime de la foi –, mais dans l’inversion de l’ordre théologique : l’Evangile cesse d’être le principe et devient un appendice du message écologique. Ainsi, l’Eglise court le risque de se présenter au monde comme une ONG verte à connotation spirituelle, au lieu d’être le sacrement universel du salut.
Lorsque l’homme perd sa place centrale en tant qu’enfant de Dieu racheté, la notion de péché et de rédemption s’estompe également. L’injustice n’est plus une offense à Dieu ni une rupture de l’amour, mais un déséquilibre écologique ou un manque de politiques environnementales. Ainsi, la foi cesse d’offrir un salut transcendant pour se limiter à un programme éthique de durabilité mondiale.
La vision chrétienne de la création
La véritable spiritualité chrétienne ne s’oppose pas à la protection du monde, mais la subordonne au mystère de la rédemption. La création est le premier don de Dieu, et sa protection fait partie du plan divin, mais elle n’acquiert tout son sens que dans le Christ, « par qui et pour qui tout a été créé » (Col 1, 16).
Le Christ est le centre de la création.
C’est pourquoi l’écologie chrétienne ne peut être comprise séparément de la christologie et de l’eschatologie. Le but de la création n’est pas l’équilibre de l’écosystème, mais la récapitulation de toutes choses dans le Christ. Les désordres écologiques sont, au fond, l’expression du désordre moral et spirituel de l’homme déchu ; leur remède ultime ne sera pas une politique environnementale, mais la conversion du cœur.
En ce sens, le véritable « soin de la maison commune » commence par la restauration de l’image divine dans l’homme. Seul un cœur réconcilié avec Dieu peut se réconcilier avec la création. Et ce n’est qu’à partir de la grâce rédemptrice qu’un ordre social et environnemental véritablement humain peut être construit.
Conclusion : la primauté de l’Evangile
Prendre soin du monde est une exigence de l’amour chrétien, mais l’Evangile n’est pas subordonné à l’écologie, il l’éclaire de l’intérieur. L’Eglise est appelée à annoncer le Christ, et c’est de cette relation filiale avec le Créateur que découle la responsabilité écologique.
Lorsque l’écologie se transforme en principe structurant de la foi, on court le risque que le salut se traduise par un équilibre naturel et que la mission se transforme en activisme environnemental. En revanche, lorsque le Christ est au centre, l’amour de la création se transforme en expression de l’amour de Dieu et du prochain.
Le défi du temps présent ne consiste pas à choisir entre l’Evangile et l’écologie, mais à remettre de l’ordre dans les priorités : d’abord le Créateur, ensuite la création ; d’abord la grâce, ensuite la responsabilité ; d’abord le salut, ensuite l’équilibre.
C’est seulement ainsi que l’Eglise continuera d’être la lumière du monde et le sel de la terre, sans se dissoudre dans les discours du temps, en rappelant que le monde ne sera pas sauvé par un programme écologique, mais par un Rédempteur.
P. Jesús Maria Silva Castignani