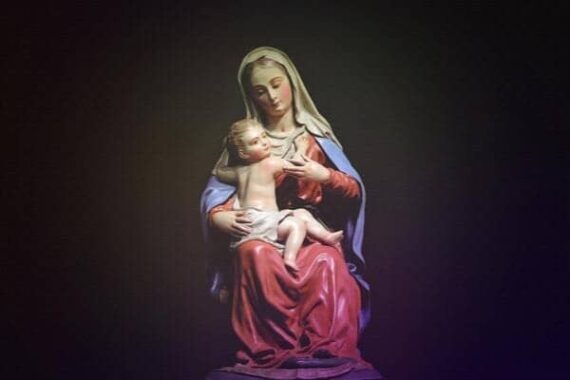La publication, mardi, par le Dicastère pour la Doctrine de la foi (DDF) d’une importante note doctrinale sur les titres à attribuer – ou non – à la Très Sainte Vierge Marie, Mater Populi Fidelis, a déjà fait couler beaucoup d’encre. On en a essentiellement retenu que le DDF refuse de donner à la Mère de Dieu le titre de Co-Rédemptrice – que certains voudraient voir défini en tant que dogme – ainsi que celui de Médiatrice de toutes grâces. Après les réactions violentes du pape François à la première de ces suggestions – il avait qualifié cela de « tonterías », des bêtises pour rester poli –, on a pu dire que la décision du Dicastère à ce sujet, et plus encore l’attitude qu’adopterait Léon XIV seraient déterminantes pour quant à la définition du nouveau pontificat : rupture ou continuité par rapport à celui de François ?
Etant donné que pour l’heure, le cardinal choisi sur mesure par ce dernier pour chapeauter ce qui fut jadis le Saint-Office, Victor Manuel dit « Tucho » Fernandez, auteur d’ouvrages bien choquants de la part d’un prélat, est toujours en poste, le rôle qu’il devait jouer dans ce document était attendu avec inquiétude.
Vu l’orientation choisie dans Mater Populi Fidelis, les jeux semblent être faits. « Tucho » y a perpétué les réticences du précédent pontife ; Léon XIV ne fait que prolonger une certaine frilosité à l’égard de la Mère de Dieu.
Le Dicastère sur la Doctrine de la foi a une vision limitée de la confusion
Mais d’un autre côté, quand on lit le document de bout en bout, la « patte » si particulière du cardinal Fernandez n’y apparaît clairement que dans l’introduction et la conclusion, soit une fraction des 80 paragraphes (près de 20.000 mots) qui le composent au total. Et il n’y a pas de violence d’expression, pas de volonté manifeste de minimiser le rôle de Marie dans l’œuvre du salut accompli par son divin Fils.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que même parmi des prêtres très traditionnels d’esprit, les opinions à l’égard des deux titres dont certains voudraient voir l’Eglise honorer la Très Sainte Vierge, médiatrice de toutes les grâces, co-rédemptrice (jusqu’à définir ce dernier comme un dogme de l’Eglise catholique), témoignent de divergences importantes. On n’est pas dans la même situation que celle qui avait cours au moment de la définition du dogme de l’Assomption, vérité largement et communément admise dans le monde catholique lorsque Pie XII le proclama en 1950…
Cependant, la manière dont la note a été reçue oscille entre la dénonciation de spolier Notre Dame de son rôle, et des louanges qui lui reviennent de droit de la part des fidèles, ses enfants, et un soulagement de voir des demandes qui pour certaines, émanent de milieux apparitionnistes, écartées après réflexion. Des réflexions qui font très largement référence à Vatican II, certes, mais qui s’appuient sur de nombreuses sources antérieures, depuis les Pères de l’Eglise jusqu’à Pie XII. Et non sans rappeler les papes – tels Pie XI et Jean-Paul II, qui n’ont pas hésité à donner à Marie le nom de Co-Rédemptrice.
« D’une manière générale, ils l’ont présenté de deux manières précises : par rapport à la maternité divine, dans la mesure où Marie, en tant que mère, a rendu possible la Rédemption accomplie dans le Christ, ou en référence à son union avec le Christ près de la Croix rédemptrice », note le document, avant de souligner que Vatican II a évité d’utiliser le titre de Co-Rédemptrice pour des raisons dogmatiques, pastorales et œcuméniques (mais ce dernier souci n’a pas empêché Paul VI, en promulguant Lumen Gentium, de la proclamer « Mère de l’Eglise »).
Marie Co-Rédemptrice et Médiatrice de toutes grâces : des réserves
La Note ne nie pas le rôle totalement à part de la Vierge Marie dans le salut, à travers sa « coopération » au « sacrifice rédempteur du Christ sur la Croix ». Elle évoque ainsi d’emblée cette phrase de saint Augustin qui « déclare donc la Vierge “coopératrice” de la Rédemption, insistant à la fois sur l’action de Marie avec le Christ et sur sa subordination à Lui, car Marie coopère avec le Christ afin que « les fidèles naissent dans l’Eglise » et, pour cette raison, nous pouvons l’appeler Mère du Peuple fidèle ». Elle affirme que Marie « a été unie au Christ, de l’Incarnation à la Croix et à la Résurrection, d’une manière exclusive et supérieure à tout ce qui peut arriver à tout croyant ».
Moyennant, donc, de longs développements, Mater Populi Fidelis affirme :
« Compte tenu de la nécessité d’expliquer le rôle subordonné de Marie au Christ dans l’œuvre de la Rédemption, l’utilisation du titre de Co-Rédemptrice pour définir la coopération de Marie est toujours inopportune. Ce titre risque d’obscurcir l’unique médiation salvifique du Christ et peut donc générer une confusion et un déséquilibre dans l’harmonie des vérités de la foi chrétienne, parce qu’“il n’y a de salut en personne d’autre”, car “il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés” (Ac 4, 12). Lorsqu’une expression nécessite des explications nombreuses et constantes, afin d’éviter qu’elle ne s’écarte d’un sens correct, elle ne rend pas service à la foi du Peuple de Dieu et devient gênante. Dans ce cas, elle n’aide pas à exalter Marie comme la première et la plus grande collaboratrice dans l’œuvre de la Rédemption et de la grâce, parce que le danger d’obscurcir la place exclusive de Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme pour notre salut, le seul capable d’offrir au Père un sacrifice d’une valeur infinie, ne serait pas un véritable honneur pour la Mère. En effet, en tant que “servante du Seigneur” (Lc 1, 38), elle nous indique le Christ et nous demande : “Tout ce qu’Il vous dira, faites-le” (Jn 2, 5). »
Notons que le mot « inopportune » renvoie plutôt à une interprétation qu’à une erreur en soi…
Co-Rédemptrice et Médiatrice… mais alors de l’unique Rédempteur
Ainsi le mot « co-rédemptrice » est-il rejeté au motif qu’il pourrait introduire une confusion au sujet du Christ, unique Rédempteur et unique Médiateur – vérité qui n’est nullement contestée par ceux qui veulent honorer Marie dans le rôle qu’elle tient de la grâce rédemptrice même de Notre Seigneur qui lui a été appliquée de manière toute spéciale par sa préservation du péché originel dès l’instant de sa conception immaculée. « Ni l’Eglise ni Marie ne peuvent remplacer, ni perfectionner, l’œuvre rédemptrice du Fils de Dieu incarné, qui a été parfaite et n’a pas besoin d’ajouts » rappelle la Note.
« Au contraire, étant associée à Lui, c’est Marie qui reçoit de son Fils un don qui la place au-delà d’elle-même, parce qu’il lui est donné d’accompagner l’œuvre du Seigneur avec son caractère maternel. Nous revenons donc au point le plus sûr : la contribution dispositive de Marie, où l’on peut effectivement penser à une action dans laquelle elle apporte quelque chose qui lui est propre, dans la mesure où elle “peut disposer d’une certaine manière” pour les autres. Car “il appartient à la puissance suprême de conduire à la fin ultime, tandis que les puissances inférieures aident à atteindre cette fin en y disposant” », affirme plus loin la note, citant la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin.
De même, la Note se refuse à promouvoir le titre de Médiatrice de toutes les grâces. On lit au paragraphe 67, qui renvoie à saint Thomas et au concile de Trente :
« Certains titres, comme celui de Médiatrice de toutes les grâces, ont des limites qui ne facilitent pas une compréhension correcte de la place unique de Marie. En effet, elle, la première rachetée, ne peut pas avoir été médiatrice de la grâce qu’elle a reçue elle-même. Il ne s’agit pas d’un détail mineur, car il met en évidence une chose centrale : en elle aussi le don de la grâce la précède et procède de l’initiative absolument gratuite de la Trinité, en vue des mérites du Christ. Elle, comme nous tous, n’a mérité sa justification par aucune de ses actions antérieures, ni par aucune action ultérieure. Pour Marie aussi, son amitié avec Dieu par la grâce sera toujours gratuite. Sa précieuse figure est le témoignage suprême de la réceptivité croyante de celle qui, plus et mieux que quiconque, s’est ouverte avec docilité et pleine confiance à l’œuvre du Christ, et en même temps elle est le meilleur signe de la puissance transformatrice de cette grâce. »
Le Dicastère de la Doctrine de la foi cite saint Thomas d’Aquin
La Note affirme en particulier (n° 53 et 54) :
« Aucun être humain, pas même les apôtres ou la Très Sainte Vierge, ne peut agir en tant que dispensateur universel de la grâce. Seul Dieu peut donner la grâce et Il le fait à travers l’humanité du Christ, car “la plénitude de la grâce du Christ homme est celle du Fils unique du Père”. Bien que la Sainte Vierge Marie soit éminemment “pleine de grâce” et “Mère de Dieu”, elle est, comme nous, fille adoptive du Père et aussi, comme l’écrit le poète Dante Alighieri, “fille de ton Fils”. Elle coopère à l’économie du salut par une participation dérivée et subordonnée ; par conséquent, tout langage concernant sa “médiation” dans la grâce doit être compris par lointaine analogie avec le Christ et sa médiation unique.
« Dans la parfaite immédiateté entre l’être humain et Dieu pour la communication de la grâce, même Marie ne peut intervenir. Ni l’amitié avec Jésus-Christ, ni l’inhabitation de la Trinité ne peuvent être conçues comme une chose qui nous vient par Marie ou par les saints. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c’est que Marie désire ce bien pour nous et le demande avec nous. La liturgie, qui est aussi lex credendi, nous permet de réaffirmer cette coopération de Marie, non pas dans la communication de la grâce, mais dans l’intercession maternelle. En effet, dans la liturgie de la solennité de l’Immaculée Conception, lorsqu’il est expliqué en quel sens le privilège accordé à Marie a été établi pour le bien du peuple, il est dit qu’elle était disposée à être “avocate de la grâce”, c’est-à-dire qu’elle intercède pour demander le don de la grâce pour nous. »
Ce danger d’une fausse interprétation du rôle de Marie est-il si présent, à l’heure où des pans si importants de la doctrine sont oubliés par une bonne part des fidèles, à supposer qu’ils les aient seulement reçus au cours de « catéchèses » défaillantes ?
Et puis, un chrétien bien formé ne sait-il pas très précisément la différence entre le Créateur et la créature, fût-elle la plus parfaite, la plus belle, la plus aimable des créatures comme Marie, Reine des anges eux-mêmes ?
Une conférence du cardinal Burke
Les arguments théologiques s’accumulent dans un sens ou dans l’autre, la discussion se poursuit… inutilement, diront certains, alors que des problèmes si graves se posent dans l’Eglise elle-même. Mais De Maria numquam satis, disait saint Bernard, on ne se tourne jamais trop vers celle qui, ayant gardé en tout la parole de Dieu, est devenue la Mère du Verbe incarné, celle que, pour cela, toutes générations proclament bienheureuse.
Ces problèmes si graves, la Mère de Dieu (enfin honorée dans son rôle singulier dans l’économie du salut disent certains partisans de la proclamation du dogme) pourrait les résoudre par sa toute-puissance d’intercession auprès de Dieu. Mais à cette fin, elle n’a pas demandé d’abord la proclamation d’un dogme sur la « co-rédemption » (sinon lors d’apparitions aussi douteuses que celle de la « Mère de tous les peuples » d’Amsterdam) mais la prière et la pénitence, et en particulier la dévotion du chapelet et des premiers samedis.
Les anglophones trouveront ici une belle conférence du cardinal Burke en 2023 sur le sens précis de la « co-rédemption de Marie » et sa médiation qui a pour but de nous conduire, non à elle-même, mais à Jésus. Ses mises au point très claires, bien avant la rédaction de Mater Populis Fidelis, mettent en évidence une certaine forme de malhonnêteté cauteleuse de ce document, même si les théologiens peuvent discuter de l’opportunité de la proclamation du dogme…