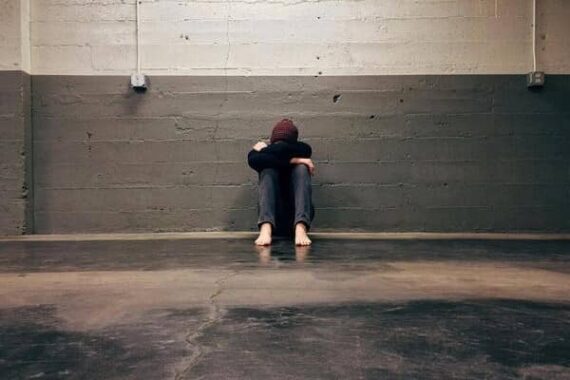Le nombre de jeunes de 16 à 24 ans sans emploi, sans études ni formation (NEET) a atteint un sommet en près de dix ans, au Royaume-Uni : un million de personnes dans cette tranche d’âge sont aujourd’hui considérées comme inaptes au travail. En cause : des problèmes de « santé mentale » qui leur ouvrent le droit à des allocations spécifiques qui les dispensent d’entrer sur le marché de travail. Cette épidémie est avant tout liée au sentiment de mal-être que ces jeunes affichent d’autant plus facilement que les réseaux sociaux les y encouragent. Démoralisation, démobilisation : une partie non négligeable des forces vives du pays sont ainsi neutralisées.
Le fléau est tel que le gouvernement travailliste britannique veut ajuster son nouveau programme d’éducation aux relations, à la sexualité et à la santé (RSHE), afin d’empêcher collégiens et lycéens de se gargariser d’auto-diagnostics fumeux à propos de leur santé mentale. Sans recul nécessaire, sans vérification médicale, ces derniers se persuadent en effet de plus en plus de mal-être divers et variés et s’écoutent surtout, manquant l’école, se préparant par là une entrée difficile sur le monde du travail.
On en dit déjà beaucoup de la génération Z (née dans les années 1990) qui serait paresseuse, égocentrée, rétive à l’autorité et prompte à démissionner, qui jaugerait avant toute chose de la rémunération perçue et de la place laissée à la vie personnelle. La génération suivante serait-elle, encore, un cran au-dessus ?
Une chose est sûre : à tous ces jeunes, il manque la vision à long terme, le contrôle de soi, le dépassement du moi… ce mélange de sagesse et de courage, d’enthousiasme et de sens de l’effort qui doit faire toute la beauté de la jeunesse. Pourrie par les réseaux sociaux (le « brain rot » que nous évoquions ici), abîmée par les méthodes pédagogiques déstructurantes et les jeux vidéo à outrance, déroutée par une éducation positive abusive, elle tombe aisément dans de fâcheux travers et ne se confronte plus au monde tel qu’il est, mais tel qu’elle voudrait qu’il soit.
Des absences scolaires record en raison de jeunes prétendument « malades »
Les enfants apprendront que « s’inquiéter et se sentir déprimé » sont chose commune : telles sont les nouvelles directives publiées dans les écoles anglaises selon The Telegraph. Il y a un certain nombre d’émotions qui, bien que négatives et désagréables, sont normales, et ne sont pas forcément de l’anxiété caractérisée ou une dépression avérée.
Si nous avons, nous, l’impression d’enfoncer une porte ouverte, il n’en est pas de même pour cette jeune génération pour qui la moindre gêne peut être le signal d’un arrêt total de la machine. Le manque, le négatif, le (moindre) mal doivent être bannis (comme s’ils ne faisaient pas partie intégrante de ce bas-monde depuis un certain péché originel). Il n’y a plus de distinction entre les affections réelles et les sentiments ordinaires.
La cause en est simple pour le ministre de l’Education britannique : « Pour trop d’enfants aujourd’hui, la compréhension de la gestion de leur humeur et de leurs émotions vient des réseaux sociaux, plutôt que de leurs parents, de leurs enseignants ou de professionnels qualifiés. »
Il faut voir, en effet, le nombre de vidéos sur TikTok où à partir de symptômes ridiculement communs, vous vous retrouvez en deux trois « scrolls », souffrant du trouble du déficit de l’attention (TDAH), d’un trouble autistique, voire du trouble de la personnalité borderline (BPD). Et ces jeunes s’en persuadent sans effort, y trouvant une justification déresponsabilisante opportune.
La conséquence inévitable ? La montée de l’absentéisme scolaire : outre-Manche, plus de 20 % des enfants ont manqué au moins un jour tous les quinze jours au dernier trimestre. Mais là encore, un trouble a été trouvé : celui de l’« évitement scolaire basé sur les émotions » (EBSA) !
A l’Université, le même problème se pose : un professeur racontait dans une chronique parue dans le Sunday Times, à l’automne dernier, comment il désespérait d’enseigner… Un tiers des étudiants de premier cycle sèchent en effet les cours et un certain nombre lui écrivent pour lui énumérer leurs problèmes de santé spécifiques jamais prouvés par des faits médicaux.
Un sur-diagnostic émanant de certaines autorités et des auto-diagnostics à la pelle
Le résultat final de cette « culture de l’absurdité » comme le dénonçait une autre journaliste du Telegraph, est sans appel : le nombre de jeunes de 16 à 24 ans sans emploi, sans études ni formation (NEET) a atteint un sommet en près de dix ans, atteignant un million.
Il y a une réalité de la chute de la santé mentale chez les jeunes, en Angleterre, en particulier depuis les confinements liés au covid. Le pays a enregistré une augmentation de 10 % du nombre d’enfants nécessitant un traitement spécialisé pour des troubles mentaux graves. Et le lien avec les chiffres croissants de l’inactivité et du chômage, chez les moins de 35 ans, sont évidents selon un rapport du gouvernement paru plus tôt cette année : les jeunes diagnostiqués avec des troubles tels que l’anxiété ont près de cinq fois plus de risques de se retrouver sans emploi que leurs pairs du même âge.
Seulement, le bon grain et l’ivraie se mélangent. Selon les dernières données du National Health Service, plus d’un cinquième des jeunes de 8 à 16 ans souffraient « probablement » d’un problème de santé mentale en 2023, soit une augmentation de sept points de pourcentage depuis 2017. Selon un récent rapport de l’assureur AXA Santé, ce serait même 30 % des Britanniques âgés de 16 à 24 ans qui déclareraient souffrir de problèmes allant de l’anxiété à la dépression, avant même de consulter un professionnel.
Il existe donc aussi un réel surdiagnostic qui vise à tout, ou en tout cas, beaucoup expliquer par la pathologie (on le voit dans la multiplication – en France aussi – des « dys » dans le milieu scolaire, qui sont pour l’immense majorité d’entre eux seulement des enfants abîmés par les méthodes d’apprentissage), que ce soit dans le milieu para-médical, au cœur des familles, et même à présent, par rebond, chez les jeunes.
De l’envolée des demandes d’indemnisation et des chiffres du chômage
Et tout cela coûte cher. La semaine dernière, un rapport a alerté sur la forte augmentation du nombre d’adolescents et de jeunes adultes bénéficiant d’indemnités maladie pour problèmes de santé mentale : les troubles mentaux ou comportementaux représentent désormais près de 45 % des demandes d’invalidité des personnes en âge de travailler. Le Parti travailliste lui-même a tenté, depuis son arrivée au pouvoir, de mettre en place une répression des ces dernières afin de permettre aux gens de reprendre le chemin de l’emploi.
On a surtout le sentiment, dans ce bel essai destiné aux écoles où il parle de « cultiver la détermination », « faire preuve de courage face aux aléas de la vie », qu’il tente de rendre normales aux yeux des jeunes des attitudes, des postures qui, de tout temps, ont toujours été évidentes. Et c’est le plus triste.
Le Dr Elaine Lockhart, présidente du corps professoral du Collège royal des psychiatres pour enfants et adolescents, cité par The Telegraph, a déclaré que la pandémie, la crise du coût de la vie avaient eu un impact significatif sur leur santé mentale ces dernières années.
Mais ces générations décervelées ont bien d’autres problèmes à résoudre, le nez et la tête dans leurs smartphones. Leur inaptitude croissante au monde du travail se voit aussi en France. Ce ne les choque même plus de voir des étrangers prendre ces places qu’ils ne jugeaient pas à leur hauteur. Et quand ce sera une IA, cela les gênera encore moins… jusqu’à ce qu’ils se réveillent ?