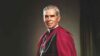L’histoire que nous vous racontions hier du « ré-ensauvagement » d’une zone de marais en Ouganda, qui s’est soldé par la destruction d’exploitations agricoles et de récoltes et à la famine dans de nombreux villages, n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres des dégâts causés par les investissements « verts » pour le « climat ». La journaliste Hayley Dickson a mis au jour plusieurs cas aberrants, financés à coups de millions et de milliards par le contribuable occidental, qui dans une société normalement constituée devraient faire la une des journaux, conduire à des audits sérieux et mettre le holà sur le « financement climatique international ». Ne rêvons pas… Le mot important est « financement », et non « climatique » : il peut faire le temps qu’il veut, la ponction des richesses est l’objectif et le discours sur le réchauffement imputable à l’homme n’est que l’idéologie développée pour le servir.
Les faits ayant quand même leur poids, l’approche de la COP30 qui s’ouvre le 10 novembre sous le signe de l’Amazonie justifie qu’on s’attarde sur la prise de conscience britannique actuelle, puisque Claire Coutinho, secrétaire à l’Energie du cabinet fantôme conservateur, vient de déclarer qu’un budget de 11,6 milliards de livres sterling (13,3 milliards d’euros) destiné à lutter contre le changement climatique était devenu « le rêve des bureaucrates et le cauchemar des contribuables ». « Le cœur du problème avec ces projets d’aide climatique est qu’ils sont totalement irresponsables et totalement opaques », a-t-elle déclaré à GBNews. Les travaillistes au pouvoir ont au contraire assuré ne pas vouloir en retirer un penny, tandis que Keir Starmer se pose en champion de la lutte pour le climat alors qu’il s’apprête à s’envoler pour le Brésil.
Les milliards gaspillés sans contrôle
Encore au pouvoir, les « Tories » ont largement participé à la mise en place, dès 2019, de ces financements courant jusqu’à fin 2025, que la COP30 menace de multiplier, mais voilà, il s’agit aujourd’hui de soigner le futur électeur et il a toutes les chances d’avoir été indigné par ces révélations du Telegraph de Londres : l’enquête de Hayley Dickson, menée pendant sept mois, a révélé que l’initiative International Climate Finance (ICF) a financé des projets tels qu’une route de 52 millions de livres sterling menant nulle part au milieu de la forêt amazonienne et un plan visant à mettre fin à la pollution plastique des océans par les pays africains… enclavés.
La fameuse route en Guyane traverse la jungle pour rallier un minuscule village de 150 âmes où personne n’a de voiture en état de marche, tout en servant principalement des compagnies pétrolières qui circulent plus facilement sur les routes enfin pavées désormais épargnées par les problèmes liés à la saison des pluies. L’idée est de rejoindre un jour le Brésil, quand de nouveaux financements internationaux viendront faciliter la reprise des travaux. On en pense ce qu’on veut, mais du point de vue du « verdissement », le projet a tout faux, depuis la déforestation jusqu’à l’aide apportée à l’extraction d’énergies dites « fossiles ».
On sait donc désormais que de nombreux programmes financés par le budget de l’ICF ont été entachés d’allégations de fraude et de corruption, tandis que d’autres semblent n’avoir que peu de rapport avec l’environnement, et les objectifs affichés : permettre aux pays en développement d’accéder à une énergie propre, d’éviter la déforestation là où la Chine a astucieusement construit une entreprise d’exploitation du bois, et de construire des infrastructures vertes, tout en se faisant aider à s’adapter et à répondre aux effets du changement climatique.
Le financement climatique international subventionne même des compagnies pétrolières
Après s’être battu pour accéder aux données en s’appuyant sur les lois de libre accès à l’information, le Telegraph a révélé qu’une partie des milliards attribués était consacrée à des programmes visant notamment à aider les compagnies pétrolières au Nigeria et en Chine, tandis que 200 millions de livres sterling ont abondé un programme visant à aider certaines des plus grandes entreprises mondiales à atteindre la neutralité carbone.
A Katmandou, l’hôtel Marriott vient ainsi d’annoncer fièrement qu’il prend « des mesures audacieuses » pour un « avenir plus vert » en s’équipant de panneaux solaires. Mais si Marriott fait partie des chaînes d’hôtels de luxe les plus riches au monde, dans cette affaire c’est le contribuable britannique qui paie au titre d’un projet public de 58 millions d’euros en faveur du Népal pour lui permettre de « faire face aux effets du changement climatique et à promouvoir un développement propre ».
Si le gouvernement britannique n’a pas donné de détails quant à des dépenses favorisant le « verdissement » de petites entreprises au Népal, Hayley Dickson précise qu’« une recherche sur les réseaux sociaux a montré qu’il a également donné des “ailes solaires” à une usine Red Bull, propriété de Saras Beverages, qui fait partie d’un conglomérat de plusieurs milliards de dollars qui gère également des sociétés bancaires et minières ».
Le financement climatique international lance des projets fantômes
Un programme de capture de carbone dans plusieurs pays africains a quant à lui été clôturé avant d’avoir lcancé le moindre projet, malgré un lancement en grande pompe en 2012, moyennant 70 millions de livres sterling d’argent public. Des projets pilotes devaient voir le jour au Nigéria et en Afrique du Sud notamment, mais la difficulté d’exécution a conduit à leur abandon. L’un d’entre eux devait même bénéficier à un projet d’une compagnie pétrolière chinoise visant à capturer le carbone de sa centrale électrique chimique et à l’utiliser pour extraire du pétrole du sol…
Les responsables du programme, initialement très bien noté, ont soutenu que ces projets prennent du temps et que les résultats espérés « ne seraient visibles qu’après un certain décalage ». Pour le coup le gouvernement britannique n’a pas voulu les suivre, les responsables du ministère de la Sécurité énergétique et du Zéro net ayant rétrogradé le programme à la note la plus basse en 2023, car « des preuves substantielles suggèrent qu’un changement transformationnel est improbable ou ne se produira pas ». Des sources ont affirmé que la plus grande partie du financement britannique a été depuis lors restituée au Royaume-Uni, sans qu’aucun audit indépendant ne puisse le confirmer, puisque les dépenses de l’ICF sont entourées d’un grand secret.
C’est ce qu’affirme en tout cas Ben Pile, chercheur et cofondateur de Climate Debate UK : « Lorsque vous parlez franchement aux personnes travaillant dans le secteur du développement, elles vous diront que les budgets consacrés à l’aide et au développement sentent la politique à plein nez. Des sommes colossales circulent et les personnes qui surveillent la manière dont elles sont dépensées sont des consultants payés plusieurs centaines de livres par jour et des ONG qui ne rendent de comptes à personne et qui sont rémunérées à hauteur de millions. Dans ce secteur, rien n’incite à dénoncer ces pratiques, qui existent depuis des décennies. »
Encore plus de milliards gaspillés après la COP30 ?
Ben Pile va jusqu’à juger que les fonds sont considérés comme une sorte de « caisse noire » qui permet au gouvernement de faire avancer ses propres intérêts : « C’est une forme de soft power. Le Royaume-Uni et l’UE n’ont plus aucun levier militaire ou économique sur la scène mondiale, ils ont donc décidé de devenir la police morale et le climat est le moyen qu’ils ont choisi pour l’affirmer. » Et cela représente tout de même 1 % du PIB britannique.
Avec ou sans Brexit, le Royaume-Uni paye… et l’Union européenne continue elle aussi de payer. Le Conseil de l’UE a publié le 27 octobre le montant de sa contribution (ainsi que celle des 27 Etats membres) au financement climatique public, soit 31,7 milliards d’euros pour la seule année 2024. Il faut y ajouter 11 milliards d’euros de financement privé. Tout cet argent est parti vers les « pays en développement » pour les aider à réduire leurs émissions de CO2 et à « s’adapter aux répercussions du changement climatique ». Les dépenses publiques sont en constante augmentation depuis 2013 (elles ne représentaient alors « que » 9,6 milliards) et l’UE a aussi l’intention d’inciter à l’investissement privé.
Le but ? Arriver à 100 milliards d’euros versés par an par les pays développés dans leur ensemble en 2025. Après quoi rien n’interdit de viser encore plus haut : les poches du contribuable ne sont-elles pas sans fond ?