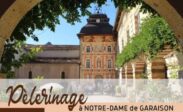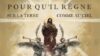La réouverture de la cathédrale Notre-Dame, samedi soir à Paris, a été à bien des égards symbolique des contrastes de notre époque pleine d’erreurs et de confusion, mais aussi de grâce et de foi. La nef de Notre-Dame resplendit désormais pour tous de sa lumière médiévale retrouvée, ses pierres blondes donnant à la haute voûte une impression d’apesanteur où les prières s’élèvent sans effort vers Dieu. Vers ce Dieu si absent de la vie ordinaire en France… et exclu de la vie publique depuis que l’Etat s’est violemment séparé de l’Eglise en 1905.
C’est le premier paradoxe. Samedi soir, des chefs d’Etat de plusieurs continents (le président élu Donald Trump y compris), des rois et des princes, et jusqu’aux membres du gouvernement Barnier déchu, se bousculaient aux premiers rangs pendant qu’Emmanuel Macron « rendait » officiellement l’édifice à l’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich. D’aucuns se sont plaints de ce que la cérémonie ait ainsi pris l’allure d’une sorte de convention des puissants de ce monde, alors qu’elle aurait dû être, disent-ils, exclusivement catholique.
Mais ne dit-on pas que parfois le diable porte Pierre – et les pierres de Notre Dame portent la foi ; elles sont l’image visible des racines chrétiennes de la France. Et elles se montrent désormais, resplendissantes, au monde entier.
Il se trouve que toutes les cathédrales et églises paroissiales du pays sont la propriété légale de l’Etat. La République française est responsable de leur entretien, tandis que le clergé catholique, à qui les édifices sont attribués gratuitement, est seul responsable de leur intérieur, de leur ameublement, de leur police et de leur décoration, dans la mesure où sa finalité, la célébration du culte catholique, est respectée et où les richesses patrimoniales sont sauvegardées. Malgré 1905, l’Eglise et l’Etat en France sont liés de multiples façons, et l’aventure de la restauration de Notre-Dame a été principalement menée par l’Etat.
L’Etat, finalement protecteur de Notre-Dame
On dira que les 850 millions d’euros nécessaires à la réalisation des travaux ont été levés grâce à la générosité des particuliers et des entreprises – largement au-delà des frontières, avec les Etats-Unis en tête des donateurs étrangers à hauteur de 55 millions d’euros – et qu’une part de ces dons ont bénéficié de la défiscalisation qui implique indirectement l’Etat dans l’effort. Mais voilà : ce sont les institutions publiques qui ont été à l’œuvre, parmi lesquelles celle créée spécialement pour la reconstruction Notre-Dame.
Il n’était donc pas aberrant que pour l’occasion l’Eglise et l’Etat s’entremêlent – mais le clergé était dans le chœur, dans le sanctuaire et Emmanuel Macron, Donald Trump et Brigitte Macron (flanquée à sa droite de Jill Biden, en l’absence de Joe), dans l’ordre, étaient au premier rang en tête de la nef – là où se tiennent les simples fidèles.
On se souviendra de l’image des Macron et d’Anne Hidalgo plantés sur le parvis dans la pluie et le vent déjà hivernaux, pendant que, dans le respect d’une vieille tradition, Mgr Ulrich frappait par trois fois de sa crosse la porte de sa cathédrale. Et résonnait le chant de la maîtrise : « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes », au son des cuivres, car l’orgue sommeillait encore. Puis les portes s’ouvrent et, cinq ans et demi après le funeste 15 avril où Notre Dame brûla, la procession des clercs entre enfin à nouveau par le Portail du Jugement pour un office religieux dans la bien-aimée cathédrale de Paris.
L’Eglise, l’Etat et les lois du patrimoine
L’occasion était grandiose, elle était symbolique, mais les ornements portés par Ulrich et les autres membres du clergé l’ont terriblement défigurée. L’archevêque avait chargé Jean-Charles de Castelbajac, couturier rescapé des tristes décennies 1970 et 1980 où la liturgie réformée croyait avoir balayé l’ancienne d’autorité, de « créer » ces nouveaux vêtements sacerdotaux dont on ne peut même pas dire qu’ils ne ressemblent à rien : comparés au logo de Google, à une pub pour LIDL ou au joker du jeu Uno, ils ont suscité une bronca tous azimuts. Castelbajac était déjà à la manœuvre lors de la visite du pape Jean-Paul II à Paris pour les JMJ en 1995, habillant les évêques et les cardinaux de couleurs proches de l’arc-en-ciel, tandis que le pape portait une chasuble ornée de croix de toutes les couleurs aux lignes enfantines. Dire que les ornements Arlequin de samedi juraient avec la merveilleuse « dentelle de pierre » de Notre-Dame et ses multiples beautés est une litote.
Cette faute de goût, qui se double – et c’est plus grave – d’une criante et criarde violation des règles liturgiques, renvoie cependant en creux vers une sorte de miracle qui s’est produit au cours de ces cinq dernières années. Nous avons échappé au pire.
Souvenez-vous : Notre-Dame fumait encore que Macron proposait d’assortir sa restauration – en cinq ans, foi d’animal ! – d’un « geste contemporain ». On avait presque ouvert un concours public pour un projet de nouvelle flèche – en plexiglass, en métal torsadé, ou muni de faisceaux lumineux, les idées défilaient dans la presse – mais contre le Président la Commission du patrimoine et de l’architecture qui imposa la reconstruction à l’identique. L’organisme public chargé de protéger les bâtiments classés et autres éléments du patrimoine a sifflé la fin de la récréation (a-t-il seulement été consulté lorsque Macron a habillé le salon Pompadour de l’Elysée des mêmes bleus, rouges et jaunes qu’affectionne Castelbajac pour ses chasubles ?) en renvoyant le Président, mais aussi l’archevêque, dos à dos.
Laurent Ulrich, en effet, rêvait d’un parcours souligné de lettres lumineuses le long des chapelles latérales modernisées pour sensibiliser à l’histoire du salut sous l’angle de Laudato si’ et de la fraternité humaine. La Commission a imposé le respect de l’existant : statues et tableaux, aujourd’hui merveilleusement restaurés en même temps que les décorations murales de Viollet-le-Duc. Le gadget des bancs soulignés de lumières bleues façon piste d’atterrissage a également été refusé ; hélas, Mgr Ulrich a pu faire approuver le nouveau mobilier liturgique de style brut que nous n’avons pas admiré au cours des cérémonies de samedi et dimanche. Mais rappelons-nous qu’ils sont amovibles : tout comme l’incendie a laissé entiers la structure, les reliques, les trésors, l’orgue, les précieux vitraux, la rénovation n’a pas détruit ce qui permettra un jour, sans doute, le retour de la splendeur liturgique. Pour la plus grande joie des fidèles sans grade et des petites gens qui vont largement pouvoir retrouver la Notre-Dame telle qu’ils l’avaient pleurée…
Nous voilà en tout cas dans la gratitude à l’égard de la puissance publique. Dieu se sert de tout.
La réouverture de Notre-Dame, un hommage à la Vierge Immaculée
A la cérémonie de samedi soir, on n’y était pas tout à fait. Ce n’est pas par hasard que les jeunes plébiscitent le pèlerinage de Chrétienté, sa liturgie sacrée, « verticale ». Rien de tel aux vêpres de samedi soir, et la procession des paroisses ne tenait pas la comparaison avec l’entrée des bannières des provinces et des saints dans la cathédrale de Chartres le lundi de Pentecôte.
Mais… Mais lorsque Mgr Ulrich a pénétré dans l’intérieur de Notre-Dame, d’une beauté à couper le souffle, c’est au son d’un motet envoûtant composé par le compositeur catholique polonais Henryk Górecki en 1987, sur les paroles de la devise du pape Jean-Paul II, Totus Tuus, tirée de la prière de saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Ce furent des minutes de paradis où la cathédrale résonnait du nom de la Vierge : « Maria, Maria, Maria… » Une hymne de louange et d’émerveillement (à écouter ici à partir de 28’55”) pour la Vierge que « toutes les générations appelleront bienheureuse ».
Il y eut un autre moment de grâce, inattendu, et encore plus paradoxal : celui du discours de Macron prononcé depuis le chœur (peut-être fut-ce par providence qu’il obtint ce qui n’aurait pas dû être, de parler à l’intérieur) devant les leaders mondiaux rassemblés. Car il a évoqué saint Louis et la Couronne d’Epines, le vœu de Louis XIII, la conversion de Paul Claudel, les étudiants « chantant » (des cantiques) au pied de Notre Dame pendant qu’elle brûlait.
L’homme qui veut passer à la postérité pour avoir constitutionnalisé l’avortement est en même temps celui qui a dit, au pied de la statue de Notre Dame : « La flèche n’était plus. Le transept effondré. Le plomb continuait de couler partout, par flammèches. L’eau. Une odeur âcre, la croix et la pieta, qui apparaissaient dans un éclat singulier. Et la Vierge au pilier, intacte, immaculée, à quelques centimètres à peine de la flèche tombée. »
La Vierge intacte et immaculée : c’est précisément ce qui la définit. C’est l’hommage, volontaire ou non, mais l’hommage quand même qui lui a été rendu en toute justice une veille de 8 décembre, par le chef d’un Etat qui la rejette par ses lois iniques, la conspue et la renvoie, en refusant d’écouter ses paroles qui résonnent toujours : « Faites tout ce qu’Il vous dira. » Marie qui est Vierge mais aussi Mère les répète inlassablement à ses enfants, et tout spécialement à la Fille aînée de l’Eglise : il est donc encore temps ! Dans sa toute-puissance d’intercession, la Vierge Marie, Mère de tous ceux qui l’aiment et la cherchent, honorée comme elle doit l’être, donnera-t-elle à la France la grâce de se souvenir des promesses de son baptême ?