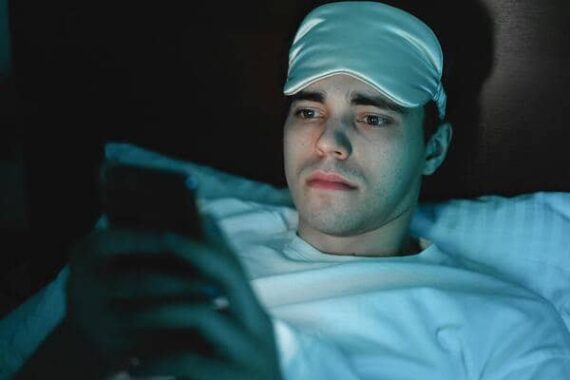Des adolescents, accrochés à leur smartphone, faisant défiler sans pause des dizaines, voire des centaines de vidéos, au format court, dont le fond hésite entre stupidité avérée et insignifiance abyssale… Cette vision est devenue malheureusement commune. Si commune que le mot de l’année 2024 retenu par l’Université d’Oxford est « brain rot », qu’on peut traduire par « pourrissement du cerveau » voire « décrépitude cérébrale ». Il désigne autant ce contenu virtuel débilitant, le plus souvent accessible sur les réseaux sociaux, que la forme de dégénérescence cérébrale engendrée par sa consommation boulimique.
Le mal du XXIe siècle ? Le souci est surtout qu’il touche les jeunes générations qui pensent faire usage d’un mode de divertissement et d’information. Alors qu’en réalité, elles soumettent, ce faisant, volontairement, une part de leur intelligence et de leur liberté. Sans compter la perte progressive de la capacité de concentration, du goût de l’effort, du travail de la volonté, de la créativité (certains jeunes l’ont bien perçu)… Et on ne parle même pas de la pratique de la lecture qui s’est, chez elles, effondrée.
L’esclavage des réseaux sociaux selon Oxford
Comme chaque année, depuis 2004, l’Oxford University Press, grande maison d’édition universitaire, a sélectionné six mots « reflétant les humeurs et les conversations qui ont contribué à façonner l’année écoulée ».
Parmi eux figuraient la notion de « dynamic pricing » ou « tarification dynamique », quand un prix d’un produit ou d’un service varie en fonction de la demande ; la « romantasy » ou « romantaisie », genre de fiction combinant romance et fantaisie ; ou encore « slop », contenu en ligne de mauvaise qualité généré à l’aide de l’intelligence artificielle (à l’origine ce mot désigne les boues qui, peu à peu, tapissent le fond des citernes des navires, notamment pétroliers.)
Mais c’est l’expression « brain rot » qui a été retenue par quelque 37.000 électeurs. Et l’augmentation de son usage par le public (+ 230 % entre 2023 et 2024) confirme cet intérêt ou même, on peut l’espérer, cette prise de conscience dans la perception de la consommation des contenus en ligne. Pour le professeur et psychologue Andrew Przybylski, interrogé par la BBC, la popularité de cette expression est « un symptôme de l’époque dans laquelle nous vivons ».
« “Brain rot” parle de l’un des dangers perçus de la vie virtuelle et de la façon dont nous utilisons notre temps libre », a déclaré le président d’Oxford Languages. « C’est comme un prochain chapitre légitime dans la conversation culturelle sur l’humanité et la technologie. »
Préoccupations et angoisses sociétales sur la pourriture de la consommation en ligne
Pourtant le terme n’est pas des plus récents. La première utilisation enregistrée du terme « brain rot » date de 1854 et vint sous la plume du philosophe américain Henry David Thoreau, dans son livre Walden ou la Vie dans les bois. A un moment de son récit, chronique de sa vie en autarcie, Thoreau s’en prend à la « dévalorisation des idées complexes » à l’œuvre, selon lui, dans la société : il y voit là, le signe d’un déclin intellectuel général.
« Alors que l’Angleterre s’efforce de guérir la pourriture sèche de la pomme de terre, personne ne s’efforcera-t-il donc de guérir la pourriture du cerveau qui sévit bien plus largement et bien plus gravement ? », y lit-on.
Mais, à vrai dire, on peut remonter bien plus loin et trouver maintes références en la matière, pour la bonne raison que c’est la pente naturelle de l’homme que d’aller vers la facilité et donc la médiocrité, de naviguer dans l’erreur plutôt que dans la vérité… Les inquiétudes à ce sujet ont toujours eu cours. Et l’apparition de nouvelles technologies ont souvent, parfois à tort, amplifié ces peurs et ces appréhensions.
Mais le plaisir glouton avec lequel les jeunes avalent ce raz-de-marée informe présent sur les réseaux sociaux, se goinfrent, se shootent de leur dose quotidienne, semble un pas supplémentaire dans l’abrutissement. Tellement qu’au début de l’année, un centre de santé mentale aux Etats-Unis a même publié des conseils en ligne sur la manière de reconnaître et d’éviter le « pourrissement du cerveau ». Pour le Newport Institute, « brain rot est un état de brouillard mental et de déclin cognitif résultant d’une utilisation excessive des écrans. Il ne s’agit pas d’une maladie médicalement reconnue, mais d’un phénomène bien réel ».
Brain rot : une dépendance à la nullité, le confort dans le chaos…
Et d’une, le défilement permanent des plateformes des médias sociaux et des contenus vidéos fait grimper la dopamine neurochimique qui produit des sentiments de satisfaction et de plaisir et donc provoque l’addiction. Et de deux, le contenu lu et vu est le plus souvent dénué d’un intérêt éblouissant. Il suffit de regarder quelques secondes la série de vidéos virales Skibidi Toilet du créateur Alexey Gerasimov qui cumule plus de 17 milliards de vues sur YouTube… Le conseiller créatif principal a parlé dans une interview au Washington Post d’« idées fraîches et nouvelles » alors que nous nageons dans l’absurde grotesque le plus total et le plus effarant.
Et le pire, c’est que le cerveau, surstimulé, en redemande ! En mars 2023, un rapport de l’Ofcom s’inquiétait que des enfants de huit ans regardassent simultanément deux vidéos, sans aucun rapport, sur les médias sociaux : c’est le phénomène de l’écran partagé. Moins d’un an plus tard, en janvier 2024, le site Petapixel évoquait le format vidéo « sludge » qui a envahi TikTok : c’est une une vidéo multi-écrans composée de plusieurs clips diffusés simultanément (le son provenant d’un seul), mélangeant cours de cuisine, défi d’influenceur, jeu vidéo et émission de télévision…
Petapixel rapporte le commentaire édifiant d’un internaute à une vidéo TikTok qui comportait plus de 10 clips superposés : « Mon esprit se sent entier. » Réflexion ô combien révélatrice. « Entier », car saturé : le cerveau est submergé et se met en mode parfaitement passif, parfaitement ingurgitatif, perdant évidemment toute capacité d’analyse. C’est, en fin de compte, le bonheur version TikTok.
Surtout ne pas réfléchir et laisser ses neurones en surface
« Il s’agit de quelque chose de ludique, qui permet de se changer les idées et qui ne nécessite pas de plonger en profondeur », explique Andreas Schellewald, chercheur doctorant en médias sociaux à l’université Goldsmiths de Londres, à NBC News. La question est de savoir si le cerveau ne va pas, lui, à force, sombrer.
Le plus frappant, comme le faisait remarquer le président d’Oxford Languages, c’est que ce mot de « brain rot » ait été précisément adopté par la génération Z (née entre 97 et 2012) et la génération Alpha (née entre 2010 et 2024), « ces communautés largement responsables de l’utilisation et de la création du contenu numérique auquel le terme fait référence ». Autrement dit, pour une part, elles voient le mal, mais en font néanmoins usage en quelque sorte.
Alors, bien sûr, tout n’est pas à balayer. Et un certain nombre d’études ont montré que la capacité de notre cerveau à traiter des quantités croissantes d’informations s’adapte, lentement, depuis un certain temps. Le tout est de savoir à quel prix. Et de garder à l’esprit que la plate soumission au règne du divertissement virtuel (car on se doute que ce n’est généralement pas de l’information de haute volée) engendre une véritable déconnexion du réel et des petits citoyens absolument malléables.